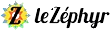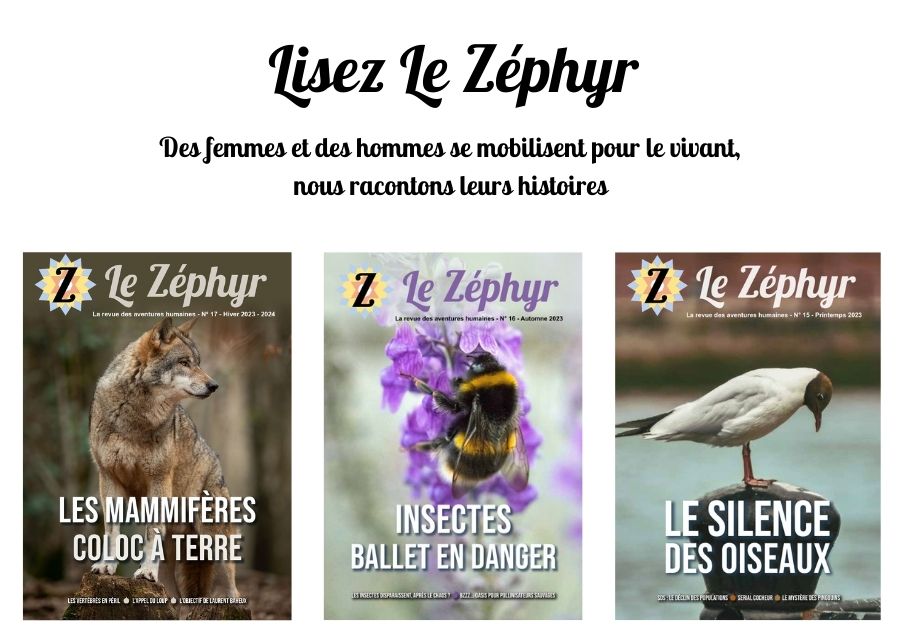TRIBUNE – Le Zéphyr propose des cartes blanches aux citoyens qui se mobilisent au quotidien pour le vivant, des scientifiques qui parlent de leur recherche, des membres d’associations, de fondations ou des artistes qui s’expriment sur leur engagement.
Les incendies se multiplient en Europe, et nous continuons de regarder ailleurs. L’ancien technicien des Eaux et Forêts, le forestier résistant Jean-Claude Nouard, également auteur et artiste plasticien, lance un cri d’alarme face au manque de volonté politique en ce qui concerne les moyens de lutte contre les flammes.
D’ores et déjà, il est possible d’affirmer que 2025 sera sans conteste, au niveau européen, l’année qui aura vu le plus de surfaces forestières partir en fumée. À la mi-août, ce sont déjà plus d’un million d’hectares qui ont brûlé, ce qui représente plus de 10 000 km², soit une surface 1,2 fois supérieure à celle de la Corse. Une surface calcinée quatre fois supérieure à la moyenne annuelle – calculée sur la période 2006-2024. Pour mémoire, en 2017, année considérée comme noire pour les incendies, la surface détruite était de 988 000 hectares.
S’agissant de nos forêts métropolitaines, l’année 2025 devrait, elle aussi, battre tous les records. Si la moyenne annuelle des surfaces brûlées des quinze dernières années se situe autour des 10 500 hectares par an, à la fin du mois de juillet on comptait déjà 238 gros incendies, pour une surface concernée de 36 890 hectares, soit 3,5 fois la surface moyenne annuelle !
Des feux qui, compte tenu du réchauffement climatique, ont lieu de plus en plus tôt en saison et qui, de l’avis des scientifiques, risquent de se généraliser à l’ensemble du territoire, tout en devenant de plus en plus incontrôlables, à l’image de celui de Marseille début juillet qui a ravagé 750 hectares de zones boisées fortement urbanisées ou encore celui dans l’Aude aux premiers jours d’août qui a parcouru plus de 17 000 hectares en moins de 48 heures !
Les origines des feux de forêt
Ces incendies seraient, selon le ministère de la Transition écologique, pour 71 % d’origine involontaire ou accidentel, pour 21 % malveillants et pour les 8 % restant d’origine naturelle – à savoir provoqués par la foudre. On peut l’affirmer aujourd’hui, les feux sont dans plus de 90 % des cas d’origine anthropique. Ils se déclenchent essentiellement à proximité immédiate de zones urbanisées.
À la suite des violents incendies de 2022, qui ont parcouru l’ensemble de l’Hexagone et détruit quelques 50 000 hectares, dont 30 000 hectares dans le massif des Landes de Gasconne (lire Le Zéphyr n°19), le président de la République en personne, sous le coup de l’émotion mais avant tout de la pression médiatique, avait fait des annonces et fixé trois axes principaux parmi lesquels le reboisement après incendie, le renforcement de la prévention et la multiplication des moyens de lutte. Or, aujourd’hui, à la fin de l’été 2O25, qu’en est-il ?
1 – Reboisement post-incendie
S’agissant des aides à la reconstitution octroyées par notre président, force est de constater qu’elles ciblent majoritairement les reboisements monospécifiques de conifères, afin de répondre favorablement aux attentes des coopératives dites forestières, des entreprises de travaux forestiers et des industriels de la filière bois, lesquels prônent le rajeunissement des forêts françaises pour une meilleure rentabilité à court et moyen termes. Une hérésie quand on sait qu’elles servent à financer la destruction des puits de carbone que sont les vieux ou anciens peuplements d’essences feuillues autochtones en place, lesquelles constituent un des remparts essentiels au changement climatique !
Ces reboisements, lorsqu’ils interviennent après un incendie, sont pour le moins inopérants, en comparaison à ce que pourrait donner une régénération naturelle bien conduite ! Une volonté politique au service de l’économie pour le moins antinomique avec la préservation de l’environnement et à contre-courant des préconisations émises par les scientifiques. Des peuplements monoculturaux d’essences comme le pin maritime, le pin noir, le douglas ou encore l’eucalyptus accentuent le réchauffement et l’acidification des sols et augmentent considérablement le risque d’incendie.
Retrouvez son entretien-fleuve dans Le Zéphyr au sujet de l’avenir des forêts.
2 – Renforcement de la prévention et des moyens de lutte
En ce qui concerne les promesses de renforcement de la prévention et de la multiplication des moyens de lutte, elles deviennent aujourd’hui un vrai sujet politique, face au constat que l’Europe se réchauffe quasiment deux fois plus vite que le reste du monde. Un réchauffement qui induit à la fois une précocité et un allongement de la période à risque et favorise la généralisation de feux de plus en plus violents. Hormis le mécanisme de protection civile de l’Union européenne, censé compléter les moyens parfois insuffisants d’un État pour faire face entre autres aux incendies, chaque pays membre dispose de ses propres moyens de lutte.
S’agissant de la France, elle disposerait de douze canadairs d’une capacité de 6 000 litres chacun, tous âgés de plus de trente ans, et de huit avions « Dash » équipés de réservoirs de 10 000 litres pouvant contenir de l’eau ou des produits dits retardant pour les feux naissants. En complément, dix hélicoptères bombardiers d’eau sont annuellement loués. Autant de moyens en matériels qui sont supposés suffisants pour fixer, maîtriser puis éteindre les incendies, désormais présents sur l’ensemble de l’Hexagone. Cette flotte vieillissante et l’ensemble de ses moyens de lutte paraissent pour le moins limités et ne semblent pas ou plus en capacité de répondre aux enjeux à venir.
Ce sont des raisons pour lesquelles, le président de la République avait annoncé dans une conférence de presse le 28 octobre 2022, le remplacement des douze canadairs vieillissants, voire inopérants, ainsi que l’achat de quatre supplémentaires. Qu’en est-il de cette promesse ?
Découvrez Le Zéphyr n°19 : une lutte sans merci contre les feux
3 – Aménagement du territoire
Au sujet de la politique de nos élus en matière d’aménagement du territoire, force est de constater que leurs objectifs se focalisent sur l’urbanisation et sur la « valorisation » des milieux naturels au profit du tourisme de masse. Des infrastructures qui génèrent ou augmentent le risque incendie, sans que pour autant les mesures préventives ou réglementaires de sécurisation des interfaces entre les forêts et les zones urbanisées, comme l’obligation de débroussaillement, ne soient formellement appliquées ou mises en place !
Autant de manquements contraires à l’intérêt général qui, en cas de sinistres, n’empêchent nullement nos dirigeants de réclamer à cor et à cri la reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle. Laquelle, lorsqu’elle est reconnue par l’État, les exonère de fait de toutes responsabilités individuelles ou collectives. Des catastrophes prétendument naturelles qui, en fait, ne sont que les manifestations de la Nature, en réaction à nos propres errements ou turpitudes. / Jean-Claude Nouard
Retrouvez le site de l’artiste.
Vous voulez rédiger une tribune sur le site du Zéphyr pour évoquer un combat ou un engagement écologique, pour évoquer votre travail de recherche ? Envoyez un mail à la rédaction (plesaffre@lezephyrmag.com). Merci