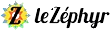4 300 km en 18 jours à vélo. L’ancien cycliste Steven Le Hyaric a traversé il y a quelques jours le désert namibien, sous une chaleur torride. Première étape d’un vaste projet un peu fou (« Projet 666 »), celui de rouler sur six déserts un peu partout sur le globe. Aventurier dans l’âme, il souhaite par l’effort sensibiliser à l’urgence climatique.
Le Zéphyr a voulu en savoir plus sur son engagement, lui qui a fui la compétition et le sport de haut niveau en 2011, ainsi que la vie de communicant, trop peu à son goût. « J’ai souvent cherché ce qui pouvait me rendre heureux », glisse-t-il aujourd’hui. En tout cas, aujourd’hui, Steven semble être sur la bonne voie, comme il nous l’a affirmé durant cet entretien.
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
« Montrer la beauté de la Terre »
Le Zéphyr : Vous vous êtes lancé dans le « projet 666 » pour traverser six déserts, pourquoi ? Et quand l’idée a-t-elle germé en vous ?
Steven Le Hyaric : L’idée a germé dans ma tête quand j’ai traversé l’Himalaya d’est en ouest en VTT. J’avais vu des populations migrer sur des territoires plus vivables pour l’être vivant (pour se mieux se nourrir et s’hydrater). Les réfugiés climatiques sont de plus en plus nombreux, en Asie et ailleurs… D’où l’idée de mettre en place cette aventure au niveau mondial. Car je souhaite me confronter à l’ensemble des continents, et cela, à vélo, qui est mon domaine de prédilection. Très vite, j’ai pensé aux déserts, notamment les plus durs de la planète. But du jeu : montrer la beauté de la Terre, dévoiler sa splendeur pour mieux la préserver, à terme.
Vous en êtes où, précisément ?
J’ai terminé la première étape, le désert namibien. Une aventure de 18 jours que j’ai réalisée à la suite d’un Paris-Dakar bouclée en 20 jours. Ce qui m’a permis de traverser l’épicentre de la chaleur avec le Sahara. La prochaine étape se déroulera en Australie ou en Mongolie, en fin d’année, je l’espère. On verra en fonction de la pandémie.
Pourquoi la Namibie, au juste ?
Le désert du Namib est l’un des plus vieux déserts au monde, il est là depuis 55 millions d’années. Je voulais montrer ses populations, ses paysages magnifiques, sa faune, c’était un rêve d’enfant de partir à l’aventure dans ce type de lieu, il y a une espèce de pureté, de calme, même si c’est très dur physiquement. L’idée, c’était vraiment de rendre hommage à la Terre. Et je suis aussi passé sur le désert du Kalahari, sur lequel la végétation est plus abondante.
« S’adapter aux températures extrêmes »
Quel est au final le plus dur dans ce type d’aventure ?
C’est d’enchaîner les journées sur des territoires variés, et aussi s’adapter aux températures extrêmes. En Namibie, je n’avais pas prévu qu’il y ait autant de différences entre la nuit (0°) et la journée (près de 50°). La chaleur arrive très vite vers 9h30 et retombe aussitôt après 17h. Ce n’est pas évident de gérer ça, au niveau du mental, pour le corps qui souffre, et en ce qui concerne la logistique, c’est-à-dire le transport de la nourriture et de l’eau.
Comment parvient-on à se préparer ?
J’ai eu une grosse préparation physique, comme il se doit, en tant qu’ancien athlète. C’est comme pour un militaire : celui-ci doit être prêt à partir sans arrêt. Et, pour cela, j’enchaîne les kilomètres à vélo en zone difficile. Je suis allé par exemple l’hiver dernier au Kilimandjaro pour m’acclimater. Il faut savoir que la Namibie est composée de hauts plateaux. 90 % de la zone traversée durant ma course se trouve à plus de 1 800 mètres d’altitude, d’où le challenge physique. J’ai été aussi à d’autres endroits afin de me tester là où la température dépasse les 40°.
Et concrètement, est-ce compliqué à mettre en place ?
Le pays était ouvert quand je m’y suis rendu. Donc c’était plutôt simple… Pour mon staff, qui a été chargé de réaliser les images et les vidéos, il a fallu que je loue un véhicule, qui a aussi servi à transporter la nourriture et les bouteilles d’eau, car il n’y a pas toujours des points d’eau potable, notamment au nord, à la frontière angolaise. En principe, j’ai consommé entre 5 et 12 litres par jour. A titre de comparaison, les cyclistes du Tour de France, c’est 15-20 litres quand il fait chaud… Après, parfois, j’ai peu bu (moins d’une bouteille et demi par jour). Mon corps s’était habitué à la chaleur extrême.
Quant à la nourriture, j’ai pu me ravitailler tous les 200 km environ, sur mon tracé. Je n’ai eu aucune assistance, mon staff a suivi un parcours parallèle. On se retrouvait le soir pour le dîner. Je dormais au-dessus du véhicule, car il faut s’éloigner du sol dans le but d’éviter les rampants (araignées, scorpions, serpents). Parfois, on se retrouvait, avec mon staff, en milieu de journée, aussi.
« Le vélo va devenir central dans nos vies »
Le sport et l’aventure attirent les foules, ce qui facilite la sensibilisation, non ?
J’en suis certain ; je pense qu’un sportif qui a couru à un petit niveau comme moi, peut donner envie de faire du vélo, d’autant que je pratique dans des lieux extraordinaires. Le vélo, c’est bon pour la santé et pour la planète. Je pense que le vélo va devenir central. Cela l’est déjà un peu depuis le début de la pandémie, mais, là, ça va prendre de plus en plus d’importance, et aussi en ville.
Et votre message peut porter, du coup, puisque vous êtes assez bien suivi…
C’est vrai que des gens m’écrivent pour me dire qu’ils se lancent dans le vélo. Cela me donne de la force. Après, je ne suis ni Nicolas Hulot ni un scientifique, mais un lanceur d’alerte. Il y en a d’ailleurs un certain nombre parmi les sportifs et les aventuriers de l’extrême. Ainsi, je peux faire passer des messages. Pendant le Paris-Dakar, j’ai ainsi montré les collines de plastiques par exemple. Des produits souvent d’origine américaine. C’est révoltant. Et je peux montrer également ce que c’est que de faire du sport dans des conditions extrêmes, comment gérer son alimentation, son corps.
Les gens qui me suivent ne sont pas forcément le public des scientifiques, ils sont sur les réseaux sociaux (Instagram, Facebook) et sont assez jeunes dans l’ensemble. Certains changent de comportements, il y a un petit coup de pied au cul, c’est plutôt positif. Il y a aussi des entrepreneurs, des chefs d’entreprise qui me suivent sur LinkedIn…
« Je suis parti au Népal après un burn out, je n’en pouvais plus de la compétition »
Le déclic, comment l’avez-vous eu, de votre côté ?
J’étais le genre de garçon à me poser dans un arbre à observer les oiseaux, j’aimais me promener en forêt. Je suis issu d’une famille d’agriculteurs. Et j’ai toujours fait du vélo. Mais, plus précisément, durant les JO de Rio, en 2016, j’étais communicant pour la fédération française de triathlon, et j’ai eu une forme de burn out. Je suis parti alors au Népal, car je n’en pouvais plus du sport de haut niveau et de cette culture de la performance poussée à l’extrême, loin du bonheur. J’ai passé du temps au sein d’un monastère, à un moment j’ai même voulu devenir moine bouddhiste.
Ah oui ?
Je suis un grand rêveur et me suis souvent posé cette question : qu’est-ce qui peut me rendre heureux ? J’ai pratiqué un peu de méditation silencieuse pendant quelques jours et me suis aventuré dans l’Himalaya. J’ai rencontré Matthieu Ricard à Katmandou et me suis rendu compte que je ne serais jamais comme lui. Il est unique et je pense ne pas être aussi patient que lui, moi qui n’avais pas énormément de capacité de concentration quand j’étais enfant à l’école. Alors j’ai compris que j’avais vraiment envie de repartir au large. Ainsi ai-je retraversé l’Himalaya, cette fois à vélo. Cela m’a rendu plus heureux que quand je travaillais dans la communication, après la fin de ma carrière sportive en 2011. J’ai été consultant freelance pour des personnalités, puis communicant pour une marque automobile pendant le Tour de France, avant de rejoindre la fédération française de triathlon.
« J’ai ressenti le syndrome de l’imposteur »
Vous étiez cycliste amateur en particulier au sein du club CC Villeneuve Saint-Germain. Vous avez notamment gagné une étape sur le Tour de Loir-et-Cher en 2010. En revanche, vous n’êtes pas passé au statut professionnel…
La compétition et la pression ne me faisaient pas rêver. Il y en a qui y arrivent, pas moi. J’ai roulé avec des cyclistes comme Adrien Petit, Romain Bardet, Christopher Froome, mais je ne me sentais pas à mon aise. Ce que j’ai particulièrement aimé, c’est l’entraînement, ce sentiment de liberté. J’aime l’aventure, pas la compétition. J’aime jouer à faire du vélo, comme on « joue » au foot. Je me suis senti libre quand j’ai quitté ce monde.
Dans un entretien sur Outside, vous avez dit notamment : « J’ai grandi en étant super malheureux. » Selon vous, y a-t-il un lien avec le fait que vous êtes « fils de », comme on dit ? Votre père Patrick Le Hyaric est directeur de publication de L’Humanité et a été aussi eurodéputé entre 2009 et 2019.
Il faudrait que je parle avec d’autres « fils de ». Ce que je sais, en tout cas, c’est que j’ai eu envie d’écrire et de devenir à un moment journaliste, mais j’ai ressenti le syndrome de l’imposteur. Peut-être y a-t-il eu de la crainte d’être comparé à mon père, qui a bien réussi ? Cela a plutôt été un frein. Je précise qu’il ne m’a jamais pistonné ou aidé. Mon père ne connaît rien au vélo et au sport de haut niveau. Pour lui, le vélo n’était d’ailleurs pas vraiment un « vrai » métier, il est un peu terre à terre, lui le fils d’agriculteurs. Certains dans ma famille exercent encore. Et c’est dur. Pour certains, continuer de travailler revient même à… perdre de l’argent. Vous imaginez ? Après j’ai suivi ma propre route, fait un peu l’inverse de mon père et de ma famille… Et, par ailleurs, je ne m’exprime pas publiquement sur mon engagement politique. J’en ai, évidemment, mais je garde ça pour moi. Et mes idées ne sont pas toutes identiques à celles de mon père. / Propos recueillis par Philippe Lesaffre