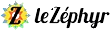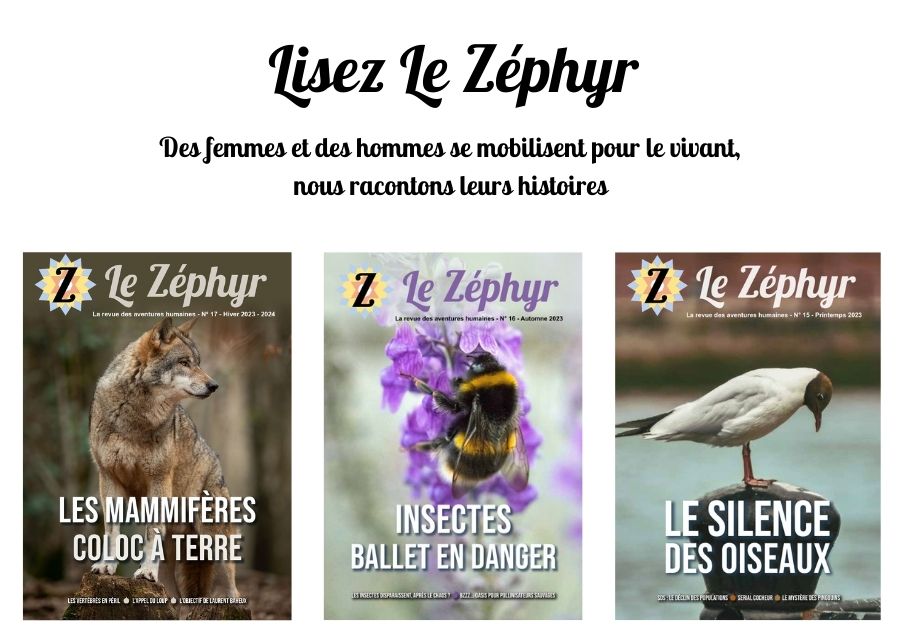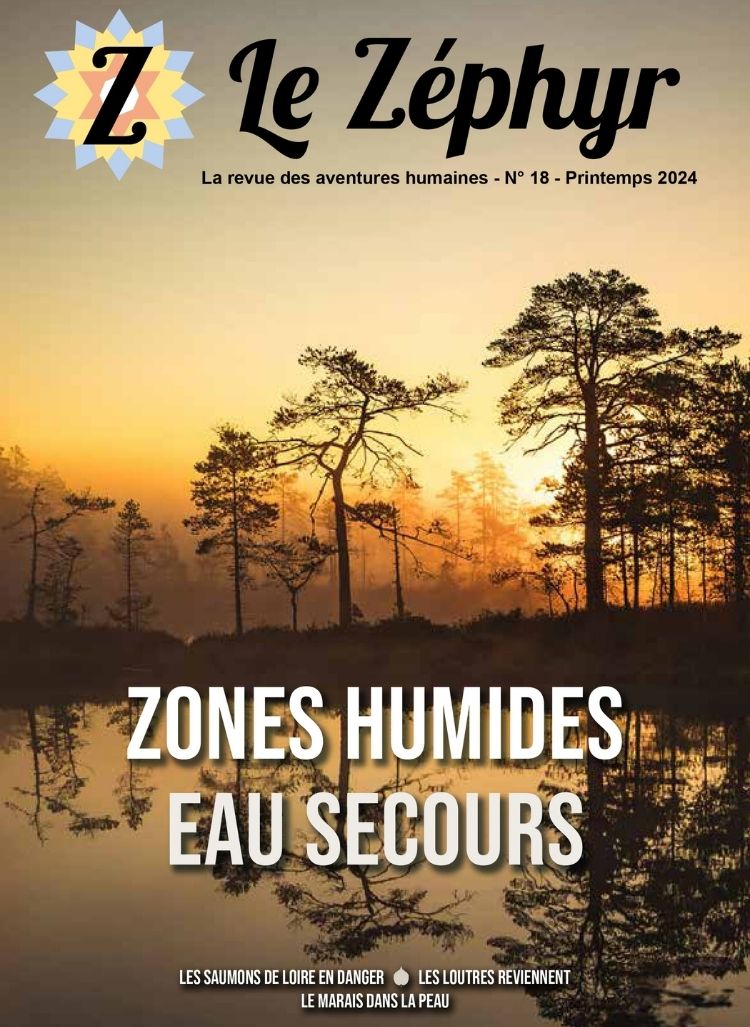Les saumons, les anguilles, les lamproies ou encore les aloses ont besoin de naviguer entre eau douce et eau salée afin de se développer et de se reproduire. Dans le bassin de la Loire, l’association Loire grands migrateurs (Logrami), veille sur ces espèces de poissons… hors des radars, mais menacées. L’heure est grave, comme l’explique la directrice de la structure de protection de l’environnement Aurore Baisez. « Ouvrons les yeux. »
Cet article est extrait du Zéphyr n°18, encore disponible. Découvrez le sommaire.
Très inquiète, Aurore Baisez (Logrami), biologiste de formation, a pris son bâton de pèlerin afin de se battre pour les espèces évoluant sous l’eau et loin de la lumière. « Comment voulez-vous qu’une espèce de poisson s’en sorte si les populations n’arrivent pas à se déplacer ? »
« Le monde des grands poissons migrateurs »
Le Zéphyr : Comment vous en êtes venue à rejoindre l’association Logrami ?

Aurore Baisez : J’ai toujours eu les pieds dans l’eau, moi qui accompagnais mon père à la pêche. Il pratique une pêche respectueuse. J’ai suivi plus tard des études de biologie et soutenu à Toulouse une thèse sur l’anguille européenne dans un marais endigué de la côte atlantique. C’est ainsi que j’ai découvert le monde des grands poissons migrateurs. Je ne suis pas tombée là par hasard : j’ai choisi de suivre un parcours de scientifique, car je souhaitais mettre la science au service de l’action pour la protection du vivant. Le but de ma démarche, c’est de faire avancer la réflexion sur la place des humains dans leur environnement. C’est ainsi que j’ai rejoint, dans les années 2000, l’association Logrami.
En particulier pour concevoir le tableau de bord des migrateurs du bassin de la Loire ?
Tout à fait. Il devenait, à cette époque, nécessaire de synthétiser les informations existantes sur ces espèces de poissons. Aucune entité ne s’en était jusque-là chargée. Précisément, j’ai été embauchée pour élaborer un tableau de bord sur l’anguille européenne dans le bassin de la Loire, puis nous en avons créé pour les autres poissons migrateurs fréquentant le milieu. Depuis le début de cette aventure, nous avons synthétisé de façon audible, avec des codes couleurs, de nombreuses données en créant des indicateurs de populations et de pressions. Tant des informations sur les comptages (de flux et de reproduction) que les données de milieux et de pression, comme la qualité de l’eau et les barrages, entre autres.
« Comprendre la dynamique des populations de poissons »
C’est un peu une fierté, j’ai lancé le premier outil de la sorte en France, il n’en existait pas encore. Le concept a ensuite été repris par d’autres associations de protection de l’environnement, et au bout de quelques années, j’ai pris en 2010 la direction de Logrami, qui vit grâce aux fonds publics.
Via le tableau de bord des migrateurs, mis à jour régulièrement, nous pouvons établir l’état de santé de ces espèces à l’instant T. L’association existe depuis 1989, et, grâce à nos longues séries de données, nous pouvons comparer chaque année, identifier la situation par rapport à des niveaux de référence scientifiques (bibliographie) et étudier les évolutions de populations des différentes espèces. Comprendre la dynamique des populations et les pressions offrent la possibilité d’identifier in fine des mesures de préservation des espèces.
Comment se portent les grands poissons migrateurs ?
Toutes les populations sont en difficulté. Sur les listes rouges de l’IUCN de 2019, l’anguille européenne et la grande alose ont été classées en France métropolitaine en danger d’extinction imminente. Par ailleurs, la lamproie marine a le statut d’espèce vulnérable. Les gens s’émeuvent souvent du tigre et du panda en danger, ce sont des mammifères très estimés, mais nous évoquons peu la situation critique de la grande alose ou de l’alose feinte, or ces deux espèces se trouvent dans nos rivières. De manière générale, les poissons sont moins étudiés et moins connus du grand public que d’autres règnes animaux, c’est dommage.
Empêcher que les cours d’eau se dégradent
Souvent on me demande pourquoi nous devons batailler pour ces poissons. Je réponds à chaque fois que si les grands migrateurs disparaissent, c’est que les cours d’eau se meurent. Il faut chercher les dysfonctionnements du côté de la qualité et de la quantité moindre de l’eau et des connectivités entre la mer et les zones de croissance ou de reproduction. Dès qu’un problème apparaît, cela se voit par la disparition de ces espèces.
Or, si les choses s’améliorent, cela se remarque très vite également par leur retour. Ce qui est avantageux. Par exemple, nous avions remarqué dès 1930 la disparition des grands migrateurs dans un sous-affluent de La Loire, la Vienne-Creuse. Un ouvrage infranchissable avait été conçu en 1920… Il a été démantelé en 1998, et l’année suivante nous avons pu observer le retour de tous les migrateurs, dont des lamproies marines. Ce sont de grandes exploratrices, elles sont revenues en nombre assez rapidement.
« La Loire est considérée comme un fleuve sauvage, mais il y a 25 000 barrages »
Pourquoi la situation est-elle catastrophique ?
Les pressions anthropiques restent importantes dans ces milieux aquatiques. La Loire est considérée comme un fleuve sauvage. Pourtant, il y a 25 000 barrages, soit un barrage tous les 2,5 kilomètres sur certains affluents. Au niveau national, il y en a plus de 100 000… C’est problématique pour les poissons qui doivent aller d’un point A à un point B pour se reproduire. Ils ont à franchir des ouvrages dans un sens puis dans l’autre, ce qui leur demande beaucoup d’énergie d’autant que moins de 4 % de ces ouvrages disposent d’un système de passage pour les poissons.
Comment voulez-vous qu’une espèce s’en sorte si les populations n’arrivent pas à se déplacer ? Nous sommes passés d’une population de 100 000 saumons de Loire au début du 19eme à… 113 en 2023. Le saumon, par exemple, se reproduit en amont des rivières, il doit ainsi aller le plus haut possible. En somme, il faut qu’il fasse près de mille kilomètres afin d’atteindre les premières frayères (zones de reproduction, ndlr). Sur l’axe Loire-Allier, il doit passer une vingtaine de barrages. Imaginez un athlète à jeun qui, après un marathon, doit faire un saut d’obstacles…
Il est temps de s’interroger : qu’est-ce qu’une rivière ? Ne s’agit-il que d’un canal ou d’un réservoir d’eau pour l’agriculture ? Où est-ce également un habitat pour une multitude d’espèces ? C’est un problème de fond zappé par la société… Petit à petit, néanmoins, nous progressons : l’eau se fait plus rare, et la société en prend conscience. C’est bien, mais Logrami alerte depuis trente ans…
« Agissons pour sauver le saumon de Loire »
Ce saumon de Loire est-il particulier par rapport à d’autres ?
Ah oui, il est unique, c’est pourquoi il faut le sauver. Sa dénomination, c’est certes Salmo salar (Saumon atlantique) comme d’autres ailleurs, mais, génération après génération, celui-ci a su s’adapter à son milieu spécifique, la Loire. Autrement dit, il est génétiquement taillé pour le fleuve, aucun autre saumon n’est capable de réaliser son parcours de mille kilomètres.
Le saumon de Bretagne, par exemple, n’a pas le même calibre, et son trajet pour rejoindre l’océan est plus court. Là, dans le bassin de la Loire, c’est une population « vierge de toute trace d’autre souche », chaque individu est issu à 100 % de cette zone. Par conséquent, si nous perdons la souche, ce serait dramatique. Je ne voudrais pas voir la fin du saumon de Loire de mon vivant. Ouvrons les yeux ! Agissons !
D’ailleurs, le saumon de Loire-Allier se distingue du saumon atlantique par un classement plus sévère (en danger d’extinction vs quasiment menacé).

Échantillonnage de juvéniles de saumons de Loire (©Logrami)
En ce qui concerne le changement climatique, est-ce un facteur non négligeable de régression ?
L’impact est énorme. Au sein de l’association, Marion Legrand a travaillé en particulier sur la phénologie migratoire, soit sur le calendrier du cycle de vie des poissons. Elle a étudié les données de comptage des migrations à la montaison (de la mer vers les frayères) pour comprendre si ces espèces changeaient leur date de migration en raison du changement climatique, et c’est bien le cas. La grande alose est l’espèce qui a le plus décalé son cycle pour s’adapter. Le saumon, de son côté, n’a pas été en capacité de modifier son calendrier migratoire.
Nous ne savons pas trop pourquoi, nous imaginons que c’est parce que la moitié des poissons sont dorénavant issus de piscicultures. Et ce sont des poissons un peu moins adaptés à la vie sauvage que les saumons natifs. Ils sont connus par les scientifiques internationaux pour être en retard dans leurs migrations.
En plus, le saumon se plaît dans des conditions plus limitées, il faut que l’eau ne soit pas au-dessus de 25 °C, car sinon il est en stress. Il meurt à 27 °C. Il n’est pas tolérant au changement de températures. Or, comme il y a moins d’eau dans la Loire et les affluents, l’eau se réchauffe encore plus vite, au grand dam, donc, du saumon de Loire. C’est un problème, chaque année, la température est plus élevée. Il faut agir, mais maintenant. Sinon, ce sera fini pour le saumon…
L’impact de la pollution…
L’eau manque à l’appel, vous le dites, et qu’en est-il des pollutions ?
Des études ont été effectuées, on retrouve bien entendu de nombreuses traces de plastique et de polluants comme les hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP). Sauf que nous ignorons quel en est l’impact sur ces poissons. Aucune bibliographie scientifique ne fait de liens entre les teneurs en particules et les conséquences biologiques sur les populations à long terme.
Nous avions organisé un colloque en 2023, et le titre était : « Un poisson ça vit dans l’eau ». L’eau doit être de bonne qualité, et il doit y en… avoir, tout simplement. Nous avons asséché la Loire, ponctionné le milieu aquatique, ce qui tue le vivant. C’est encore pire pour les milieux humides, qui disparaissent à tous les niveaux, en amont en tête de bassin, en zone de plaines et du côté des estuaires. Pourtant, ce sont des éponges idéales pour les relargages d’eau en été ou d’absorption des débordements des rivières. Nous en avons besoin, or nous les remplaçons parfois par de gigantesques bassines favorisant l’évaporation et l’augmentation de température, cherchez l’erreur.
…et de la surpêche
Et la pêche, dans tout ça ?
Est-ce logique d’autoriser des captures sur des populations dont les espèces sont en danger d’extinction ? Non. C’est une évidence, la surexploitation des milieux aquatiques est une aberration. Nous sommes loin d’une pêche raisonnée… Typiquement, il faudrait un moratoire sur la pêche de l’alose et de la lamproie marine. Sur cette dernière, nous sommes passés de 90 000 individus dans le bassin de la Loire dans les années 2007 à… 15 en 2023. Comment pouvons-nous envisager de poursuivre la pêcherie ? Nous avons réussi à interdire la pêche du saumon en 1991. Le projet avait été porté par les fédérations de pêche, alors j’ai de l’espoir que les consciences se réveillent du côté de la profession.
Du côté des anguilles, quelle est la situation ?
Elles se reproduisent en mer et viennent pour leur croissance sur les côtes. Les larves se développent et se transforment en civelles. Depuis le sud de la Gascogne, elles arrivent grâce au Gulf Stream en Bretagne, en passant par le bassin de la Loire, entre janvier et mars. L’anguille a été outrageusement pêchée : jusqu’à 526 tonnes par an sur la Loire en 1980. Pour information, dans un kilo de civelles, il y a 3 600 individus. Conséquence : la population a chuté. Nous estimons sa population à 1 % de ce qu’elle était dans les années 80.
« Nous sommes trop gourmands »
Je résume : elle arrive dans la Loire, elle se fait capturer au stade de civelles, le voyage est dangereux… Mais ce n’est pas fini, elle est capturée quand elle est résidente et en phase de croissance (on dit : anguille jaune) et ce n’est pas fini, sur son chemin du retour, en direction de l’océan en vue de la reproduction après huit-dix ans de croissance, elle peut se faire attraper aussi. Les dangers, pour elle, c’est donc à chaque stade de développement : au stade de la civelle, de l’anguille jaune (après la migration) et de l’anguille argentée (au moment de l’avalaison vers la reproduction dans l’océan).
Nous sommes trop gourmands. Nous devons tous faire un effort, en Europe. En 2007, l’Europe a demandé aux États membres de mettre en place des plans de gestion dans le but de garantir la sortie dans l’océan d’au moins 60 % de ce qu’aurait produit le bassin sans activité humaine, sur la référence de la production des années 1980. De nombreux pays du Nord laissent dorénavant revenir en mer les anguilles. La France est mauvaise élève, elle n’a pas fait beaucoup d’efforts. La capture reste possible à chaque stade de développement du poisson, et peu d’aménagements ont été effectués en sa faveur.
Là, l’anguille revient au niveau de la Loire, l’effort européen porte un peu ses fruits, mais c’est surtout grâce à nos voisins. L’Ue a demandé à ses États membres de réduire la voilure sur la capture, mais il y a des dérogations au niveau des dates de pêche…que la France s’est empressée de proposer.
« Les marais vendéens se détériorent »
De nombreuses anguilles se trouvent au sein des marais vendéens, or, ils se détériorent. Pourquoi ?
Les marais ont été conçus par les humains pour produire du sel, à l’origine. Aujourd’hui, ils sont plutôt consacrés à la pisciculture. L’idée a été de faire entrer des poissons depuis la mer pour les faire grossir au sein de ces territoires. Des daurades, des bars, des mulets, des anguilles, des espèces dont les populations, aujourd’hui, ont diminué. Les marais, il faut en prendre soin. Sans intervention, ils se transforment. Ils s’envasent, la végétation pousse, le milieu se referme. Or, ces marais, en grande majorité privés, sont abandonnés, ils sont de moins en moins entretenus, pour des raisons financières essentiellement. Je pense au curage, à l’entretien des plantes envahissantes, des digues… L’océan cogne, nous l’avons vu durant les tempêtes, de plus en plus violentes.
Ils sont nés de la main des humains, il n’empêche, sur ces territoires, la biodiversité y est riche. La faune, la flore s’y retrouvent, d’autant plus qu’il n’y a pas d’intrants. C’est artificiel, mais c’est très proche d’un système naturel. Et du coup, il faut les protéger, cela va de soi.
Les solutions pour préserver ces milieux
Comment y parvenir ? Comment votre association intervient-elle en Vendée ?
Il y a des solutions pour que les marais vivent… J’explique en premier lieu que cela ne sert plus à rien d’élever la hauteur des digues advita eternam, vu le niveau de la mer qui grimpe, année après année. À un moment, il va falloir faire des choix, et laisser des territoires à l’Atlantique. Autant vous dire que je suis sur ce coup-là un peu seule. C’est très douloureux comme discours. Néanmoins, il est nécessaire de préparer l’avenir. C’est un travail de longue haleine, mais il faut sensibiliser les acteurs, leur faire comprendre qu’ils ne pourront pas lutter pour certains territoires contre le dérèglement climatique.
Les propriétaires de marais ont une responsabilité à entretenir leurs territoires entre terre et mer. En tout cas, Logrami est de cet avis et accompagne les acteurs sur le terrain en ce sens. Il y en a un par exemple qui l’a bien compris, c’est le marais du Payré, du côté de Talmont-Saint-Hilaire, que l’association aide depuis 2008. On trouve désormais de l’écopâturage pour lutter contre le baccharis. Les gestionnaires s’occupent du curage, ils entretiennent le lieu. En une décennie, ils ont su retaper 90 hectares de marais, sur 850, en tout.
À Saint-Gilles-Croix-de-Vie, nous avons proposé un modèle de gestion différent. C’est un mix entre un milieu complètement anthropisé et un marais plus naturel, ouvert à la mer. En tout cas, cela permet aux anguilles d’entrer et de sortir comme elles l’entendent. Logrami a réalisé un état des lieux en 2022, des travaux ont été entrepris l’année suivante. Actuellement, nous suivons les recrutements de civelles et d’anguillettes (le stade après la civelle, ndlr) qui rentrent dans ces marais. Nous verrons en 2025 quelle sera l’abondance d’anguilles jaunes, nous analyserons les populations dans la durée aux côtés des propriétaires et du Syndicat mixte des Marais de la Vie, du Ligneron et du Jaunay.
Cependant, au sein des marais vendéens, de nombreuses anguilles, n’arrivent pas à rejoindre les océans, car la sortie des marais est compliquée ou bloquée, les marais se sont détériorés. Il y a donc un énorme travail de sensibilisation à faire et de restauration de ces territoires, notamment pour l’anguille européenne.
L’anguille est cuivrée, et c’est problématique
Vous dites qu’il est parfois compliqué de convaincre les uns et les autres…
Il ne faut pas cesser de montrer, de démontrer, d’expliquer pour que les acteurs aient envie de nous suivre. Il y a une solution pour leur montrer les conséquences d’un marais fermé. Si le site bloque la sortie des anguilles argentées (celles qui veulent aller en mer), ces dernières vont se retransformer. Par exemple, au niveau du marais de la Vie, nous avons identifié un certain nombre d’anguilles… cuivrées. Il s’agit d’un stade qui n’existe pas en tant que tel, mais que j’ai inventé (Rire).
C’est-à-dire ? L’anguille devient cuivrée, car elle n’a pas quitté le marais ? Racontez-nous…
L’anguille jaune, quand elle se transforme pour devenir une anguille argentée, prête à rejoindre les profondeurs de l’océan, aura l’œil qui va grossir. Elle a des pigments rétiniens qui se mettent en place, comme une baleine… Des petits capteurs vont aussi pousser sur la ligne latérale du poisson (au milieu de son corps) pour qu’il se situe dans l’eau. Enfin, sa couleur va évoluer : le ventre passe du jaune (ou marron) au blanc, le dos devient noir, ce qui lui permet, dans l’obscurité marine, de passer inaperçu. Manière de se protéger des prédateurs.
Après la métamorphose, les anguilles démarrent leur traversée, mais beaucoup vont se retrouver coincées dans les marais vendéens. Les barrières qui les empêchent de retrouver l’Atlantique sont infranchissables, donc les poissons décident de faire demi-tour. Elles qui avaient cessé de s’alimenter (pour que le tube digestif se transforme et laisse de la place aux futurs œufs) vont se nourrir à nouveau.
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
Et, dans ce cas, il y aura un rétropédalage aussi anatomique : elles vont reprendre les formes de l’anguille jaune, le stade précédent. Sauf que la transformation est un peu ratée : elles sont devenues des anguilles un brin différentes… avec des teintes cuivrées. Les couleurs sont magnifiques. Mais leur présence signifie qu’il y a eu un dysfonctionnement, ce que j’essaie d’expliquer aux gestionnaires. Le milieu dans lequel elles évoluent a cassé l’évolution de leur cycle de vie. C’est un souci de continuité. Les anguilles peuvent entrer dans le marais, mais ne peuvent pas rejoindre l’océan, cela bloque la reproduction.$
« Inciter les uns et les autres à se mobiliser pour le vivant »
Comment débloquer la situation ?
Il faut y aller, pas à pas, ne pas brusquer. Toujours au même endroit, sur le site du marais de la Vie, en 2023, des travaux de restauration, en particulier les curages et le faucardage (l’action de couper la flore envahissante, ndlr), ont été financés par le syndicat (via Natura 2000). En contrepartie, toute capture d’anguille est interdite dorénavant. Nous verrons comment cela évolue en 2025.
De façon plus générale, si nous passons de 3 à 100 kilos d’anguilles à l’hectare, ce sera alors plus facile pour convaincre les gestionnaires d’adopter des modes de gestion plus doux.
Quel est l‘argument qui marche le mieux pour persuader les gestionnaires ? Ce n’est pas forcément la défense du vivant ?
Dans toutes les décisions de gestion (pas seulement sur ces territoires), tant que vous ne leur montrez pas qu’ils ont intérêt à prendre telle ou telle décision, alors ils ne sauteront pas le pas. Il faut comprendre que ce qui les pousse à protéger la biodiversité, c’est l’usage qu’ils en ont, avant tout. Beaucoup acceptent de protéger le vivant si cela leur sert, s’ils en trouvent un bénéfice (pas forcément économique, dans le cas de marais). La préservation des zones humides d’une manière générale est toujours valorisée pour les nombreux bénéfices qu’elles apportent aux humains, et non par rapport à ce qu’elles sont…
Pour autant, il y a une prise de conscience citoyenne, non ?
Oui, je remarque que beaucoup de citoyens évoluent et désirent que les pratiques changent, en effet. C’est bon signe. L’association que je dirige accompagne également les plus jeunes. Nous sensibilisons de façon ludique (via des jeux que nous avons imaginés) sur la question de la faune aquatique, sur les milieux humides ou sur le rôle écologique des rivières…
L’association publie aussi des bandes dessinées pour raconter, aux jeunes et aux moins jeunes, l’histoire de poissons. En 2023, Logrami a en particulier publié l’album Voyage avec les anguilles. Cela peut être utile.
La preuve : après la sortie d’une première BD, au sujet des saumons de l’Allier, un ouvrage appartenant à Vinci Autoroutes au niveau de l’A89, vers Clermont-Ferrand, a pu être démonté en 2019 : il freinait le passage de saumons dans l’Allier… Donc il y a du positif, il faut garder de l’espoir ! / Propos recueillis par Philippe Lesaffre
Retrouvez les autres articles de ce numéro sur les milieux aquatiques et humides : Le Zéphyr n°18