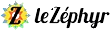Le « poète de proximité » Marien Guillé prend la plume. Laissez-vous surprendre par son récit de voyage, en France.
Vous en êtes à l’épisode 2 : « Au coeur de la Puisaye »
J’ai tout un pays à découvrir. Autant démarrer par l’origine. D’où remonte mon plus profond souvenir ici ? Moi qui ai traversé des milliers de kilomètres, où ont eu lieu mes premiers pas ? La maison de famille, à Saint-Fargeau, habitée seulement pour de courtes périodes, laissée le reste du temps à la merci du silence. Vendredi, un passage éclair chez les parents pour récupérer la clé, et tout de suite, un nouveau départ pour l’enfance.
Samedi, 17h30, gare d’Auxerre. J’attends le bus à destination de Saint-Fargeau. Lorsque je me renseigne, on me dit qu’il n’a pas de place attitré, qu’il se gare où il peut et que je dois rester vigilant : comme il y a très peu de passagers sur cette ligne, parfois, c’est une simple voiture.
Quelques minutes plus tard, un bus blanc s’arrête. Je demande au chauffeur, il m’indique une voiture garée un peu plus loin. Je presse le pas, une dame sort du véhicule et me sourit : « Saint-Fargeau ? Ah ben il est mon premier client de la journée ! » Cette dame avait fait les allers-retours depuis ce matin, sans aucune compagnie, seule sur les routes de Puisaye. Je monte devant. On quitte Auxerre en passant par un arrêt où de nombreux handicapés mentaux se retrouvent. Ma conductrice en connaît un paquet, c’est elle qui les transporte à leurs centres d’insertion durant la semaine. Elle leur fait signe. Une poésie toute silencieuse émane de leurs visages au poème écorché mais doux. Une douceur naïve, malicieuse, un retrait du monde, une lenteur qui les honore.
Dans la bouche de cette femme, « vous » devient « il »
Nous les remarquons toujours sans rien dire, mais, eux, comment nous regardent-ils ? Ils sont nombreux ici, et c’est comme s’ils vivaient sans se rendre compte de leur différence. Leur pas est le même. Leur souffle est le même. Leur silence est plein d’histoire. Si je leur confiais ma vie, ils n’en feraient pas le commerce. Ils en prendraient soin. Le bus devant nous, qui va à Saint-Sauveur, c’est celui de son mari. Il prend quand même quelques passagers par jour, alors, lui, il a un vrai bus. « Alors, il retourne sur ses lieux d’enfance, c’est ça ? »
Sur la route, on papote. Elle me parle d’elle, de son métier, de son village. Les rouges vifs et les oranges bruns d’automne nous accompagnent le long des paysages vallonnés. Tout ce qui vit se prépare à des changements, se protège et s’ouvre à la fois. Pour bientôt briller dans la neige.
« Oh, en stop, il aurait trouvé. » Les premiers bourgs apparaissent. Villefargeau. Puis Pourrain. Ça y est, nous sommes en Puisaye. De longues rangées d’arbres immenses, qui se tiennent bien droits, dressés comme des cathédrales de sève et de lumière.
« Mais comment il va faire pour se déplacer sans voiture ? »
Je me demande à plusieurs reprises pourquoi, dans la bouche de cette femme, « vous » devient « il ». Quelle affaire d’être questionné sans adresse directe ! D’être apostrophé à la troisième personne en sa propre présence !
Tandis que nous parlons de choses et d’autres, entrecoupés de silence, je dresse dans ma tête la liste de tout ce que je me souviens de cette maison de famille où j’ai passé de nombreuses vacances mais qui n’est plus habitée qu’épisodiquement par ma grand-mère. D’abord, il y a l’odeur des gougères. Puis le potager, la remise, le portillon au bout avec la vue sur le champ infini du voisin – la cave rempli de charbon – les grandes pièces vides, humides et froides – les odeurs ineffables, propres à chaque pièce…
Soudain, dans un champ, ma conductrice ralentit puis montre du doigt un chevreuil immobile, et un chat, près de la maison, qui le fixe de ses petits yeux. C’est la première fois que je voyage avec un chauffeur de bus qui prend le temps de me montrer la magie de la route. Elle me raconte qu’un jour, son mari a vu par la fenêtre – car tout n’est pas grillagé autour de chez eux – une biche et son petit venir sur la pelouse et passer l’après-midi là. Il a filmé avec le petit caméscope et lui a montré le soir, lorsqu’elle est revenue du dépôt. De temps en temps, ils ont eu cette visite de nouveau, mais sans être sûr qu’il s’agissait de la même biche.
« -Il est sûr qu’il veut pas que je m’arrête pour prendre une photo ? »
Le ciel vire à l’incendie. Le soleil se couche au bout de l’horizon. Les vitres de la voiture sont parfois éblouies par les jets de lumière. Je suis dans un transport public et c’est comme si j’avais fait du stop. La proximité avec cette personne est totale. On pourrait se tutoyer, se chambrer, se prendre dans les bras. La région est venue me chercher et c’est comme si j’étais un étranger accueilli dans ma propre maison. Un jour, me dit-elle, avec son mari, ils ont été missionnés pour emmener des parisiens à un festival de musique en Hongrie. Ils étaient logés avec d’autres chauffeurs dans un petit hôtel-restaurant à la campagne. Ils ont loué une voiture et ils se sont promenés. Ils ont eu des sacrés fous rires avec les autres, et ils sont même restés en amitié avec certains d’entre eux, qu’ils contactent encore parfois au téléphone.
Mes souvenirs accourent
Après Pourrain, Toucy. Puis Mézilles, où l’église porte le nom de « Saint-Marien », en référence à un ermite pèlerin des premiers siècles de notre ère, qui accompagnait les troupeaux. Il marchait pieds nus et pouvait redonner la vie aux bêtes tuée par les prédateurs.
« Ça y est, il reconnaît la route ? »
Ma conductrice me ramène sur terre, au cœur de la Puisaye, dans le présent. Elle me parle de son frère et de sa sœur, décédés tous les deux. Il ne lui reste plus qu’un frère qui vit loin et un peu isolé. Le rêve d’une maison achetée tous ensemble en Bretagne s’est effondré.
Puis Ronchères, petit village aux toits rouges. Et enfin apparaît le panneau « Saint-Fargeau », suivi immédiatement de l’affiche du spectacle historique, principale attraction du village, tous les weekends de l’été. On s’enfile dans la grande rue, avenue du Général Leclerc. Le bout de la route, c’est le bout du village. Au niveau du numéro 37, mon cœur se serre. 35. 33. La vigne vierge. La grille peinte en vert. Le garage. Les volets bleus qui virent au blanc. Mes souvenirs se posent sur les chemins de ma mémoire, comme les feuilles mortes d’automne au pied des marronniers le long de la route départementale. Mes yeux reconnaissent immédiatement ce château de Puisaye miniature, comme si j’en avais fermé la grille la veille au soir. En voyant mon corps se redresser sur le siège, ma conductrice comprend qu’on est à destination. Elle ralentit en passant devant la maison, tandis que tous mes souvenirs accourent, pressent le pas, débordent du trottoir, manquant de se faire écraser.
Cette femme pensait simplement m’avoir emmené à destination, mais elle ne réalisera jamais le voyage qu’elle m’a offert. Elle m’a accueilli comme un étranger dans ma propre maison.
Je demande à ce qu’on s’arrête un peu plus loin, à l’arrêt habituel, en face du Musée du Son.
« – Il est sûr qu’il veut pas que je le dépose devant ? Ça m’est égal.
– Non, non, continuez, laissez-moi un peu plus loin : je veux arriver à pied.
– Ah… je fais comme il veut ! »
C’est précisément dans cette maison que j’ai mon tout premier, mon plus lointain souvenir d’être vivant, avec mes yeux de quelques mois, un an tout au plus. Je revois ce jour, le soleil était puissant, il traversait le couloir comme la marée montante. La grande porte était ouverte. Je revois l’agitation de ma grand-mère dans ses habits de gitane, son gilet bleu et son mouchoir à la main. Et ces hommes, immenses, habillés de salopettes blanches et de gants jaunes que j’assimile dans mon souvenir à des géants, à des héros – en réalité des déménageurs – aux dos courbés, le menton relevé, aux bras pliés sous le poids de meubles qu’ils sortaient un à un de la maison – des commodes, des tables, des vaisseliers – qu’ils chargeaient dans le grand camion blanc garé devant la grille, des meubles dix fois plus grands qu’eux, cent fois plus grands que moi. Et je les regardais, assis sur la première marche de l’escalier qui jouxte les chambres et les pièces à vivre, comme la colonne vertébrale de la maison. J’étais là, assis, fasciné par ce spectacle.
Une maison remplie de trésors
Étais-je en train de me demander si ces géants nous cambriolaient avec notre consentement ? Étais-je en train de m’imaginer un jour, capable de porter le buffet du salon sur le dos, moi aussi ? Ou étais-je en train d’imaginer, déjà, ma nouvelle chambre, et le long voyage à venir et le nouvel horizon qui nous attendait ? Est-ce que mon goût pour la vie nomade naquit ce jour-là, dans l’effervescence de ce déménagement vers le sud de la France ? Le souvenir s’arrête ici, il est très furtif. De la maison suivante, aucun souvenir. Ma mémoire part en vacances et me rattrape à l’école maternelle, j’ai quatre ans, je suis muré dans un silence d’autisme affectif, j’écoute le bruit que fait la classe en train d’interagir avec la maîtresse, tandis que je m’extraie de la scène, m’évadant dans mes pensées, pour savoir le bruit du monde lorsque je n’y suis pas.
Je tourne la clé. La grille grince comme on attend d’une grille qu’elle grince pour accueillir. Cette maison m’a toujours paru immense, avec mes yeux de gosse. Et remplie de trésors, dans l’obscurité et la poussière des chambres inutilisées du second. Aujourd’hui, je n’y découvre que des cartons vides, conservés avec soin par ma grand-mère sous des serpillères et des torchons, dans sa manie de ne rien jeter et de projeter sans cesse une utilité future, certaine et évidente, à la moindre petite chose, bocaux, fil de fer, bouteilles vides, cartons, vêtements déchirés, pinces à linge, bac à fleurs même si le printemps ne viendra plus, chaises bancales même si plus personne ne vient s’asseoir.
J’avais pris mon duvet dans le cas où la maison serait froide et ne trouverais pas assez de couverture. Le courant est coupé : J’écris à la lumière d’une bougie. La flamme s’étire comme un oiseau qui tente de s’envoler, retenu par des chaînes invisibles. Toute la pièce est enveloppée de clarté. La flamme vacille mais reste à son poste. Je n’avais pas, depuis longtemps, fixé toute mon attention sur une bougie éclairant une pièce sombre aux rideaux tirés. C’est un spectacle déchirant et sublime, le combat de la lumière pour tenir son rôle de flamme.
Je domine le jardin
Les pièces sont vides et froides. La présence s’est entassée dans des cartons prêts-à-partir, comme des passagers en attente de destination, endormis dans le hall d’un aéroport. En 1954, mes grands-parents se mariaient à quelques rues d’ici, les yeux pleins de fleurs, remplis de jeunesse et d’insouciance. Même les photos sont restées jeunes, coquines, amoureuses. Comment sont-ils devenus ces corps qui marchent lentement, en silence, dépouillés de toute joie, saisis par la crainte du monde ?
Deuxième jour, premier matin. J’ouvre les fenêtres pour m’enivrer de fraîcheur. L’odeur de terre humide remonte du sol. Je m’accoude sur le rebord. Dehors le ciel est sale comme un bleu de travail, on dirait qu’il se rend à l’usine. Les nuages tâchent ses manches que pourtant il retrousse chaque matin. Par la fenêtre, je domine le jardin. Des grues passent et chantent dans le lointain du ciel, en traçant d’immenses lettres en forme d’oiseaux. Le sol est rempli de jeunes pousses qui ne passeront pas l’hiver. La terre est en friche. Plus aucune trace de la rhubarbe qui recouvrait le mur de brique. Les poiriers sont morts depuis longtemps sans sépulture, et le cabanon de pierre n’abrite plus que des arrosoirs percés et des gants poussiéreux. La vigne vierge colonise tranquillement le mur. L’abandon a pris possession de ce royaume et les maigres efforts d’une vieille dame n’ont pas réussi à limiter l’envahisseur.
Au bout de l’allée, un vieux portillon donnait sur le champ du voisin – immense, dans mes souvenirs, petit en réalité. Désormais, il est recouvert de ronces et caché par les mauvaises herbes, ce qui ne donne plus vraiment de raison au portillon de rester un portillon.
Il ne fait plus que double emploi et emploi fictif. Au loin, les arbres. L’horizon de cimes. Sur chacune d’entre elles, une infinité de nids d’oiseau. Il faut aimer le vis-à-vis.
Jouer à l’écrivain
Le lendemain, je me rends sur la tombe de mon grand-père. En revenant du cimetière, je grimpe au grenier. Le soleil passe à travers les lucarnes et sa lumière fait danser la poussière dans le vide. Les vieilles portes, que personne ne pousse jamais, grincent comme des rires d’enfants. Au plafond, au-dessus des malles, des paniers et des cageots, un velux trône comme un tableau dans un musée. J’ai toujours été trop petit pour voir à travers, même sur la pointe des pieds. Aujourd’hui, je vois le ciel à travers. Et même si le velux est atrocement sale, le ciel, lui, ne m’a jamais été révélé comme aujourd’hui.
Dans le fond à droite du grenier, derrière une petite porte sous les poutres, un petit recoin isolé. C’est dans cette pièce au plancher de bois, que j’allais, selon les dires de ma grand-mère, jouer à l’écrivain, « vivre ma vraie vie », comme je disais. C’est là que j’imaginais des histoires qui ne sortaient jamais de cette pièce, ni de mon esprit. Il y avait une sorte de petite table de nuit, avec de nombreux tiroirs, qui me servait du pupitre. Et puis une minuscule vitrine à clapets, bricolée en bois, posée sur un petit bahut vieillot. Je passais mon temps à l’ouvrir et à la fermer pour y prendre ou y déposer des objets imaginaires. Elle était vide, bien entendu. Je n’écrivais pas. Je faisais semblant. Des heures durant, j’étais ici comme au-dessus du monde. Le dieu du grenier.
À la boulangerie, elles sont là, dans le présentoir. Comme de gros beignets aux formes irrégulières. De la pâte à choux avec du gruyère dedans. C’était l’odeur qui correspondait aux vacances, à notre arrivée ici au début de l’été, lorsque la voiture sortait de l’autoroute. Nous nous arrêtions parfois même avant d’être arrivés à Saint-Fargeau, comme un avant-goût.
« – Bonjour, quatre gougères s’il vous plaît. Au fait, vous écrivez ça comment ? Avec un j ou avec un g ?
– Oh, qu’est-ce que j’en sais, moi », dit l’une des boulangères.
« – Ça s’écrit pas, ça se mange ! » ajoute l’autre.
Après une promenade enivrante dans les couleurs d’automne au milieu des étangs de Puisaye et des Arbres Verts – immense forêt dressée vers le ciel – je reviens au village par le chemin de Lavau. Le cœur de ville est désert. Les maisons se ferment Les visages aussi. La Puisaye offre de superbes paysages, mais c’est une région gangrenée par l’alcool, le chômage et l’ennui. Des situations de grande détresse et de solitude poussent les individus du côté de l’isolement, de la peur, de la méfiance.
Les rues respirent la solitude. C’est une région qui s’abîme comme s’abîme le cœur des gens qui se réfugient dans des bâtisses trop grandes et mal chauffées. De rancœur, les familles se déchirent jusqu’au cimetière, où elles sont éparpillées dans des tombes différentes, loin les unes des autres. Les maisons se dessèchent. Les magasins ferment, les bars ont leurs habitués irréductibles, l’auto-école cherche ses clients. Le vieux lavoir et l’écluse sont lettres mortes. Le ruisseau qui traverse le village s’appelle le Bourdon. Ça ne s’invente pas.
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
Des coccinelles dans les draps
Le soir, lecture à la bougie. Henri Michaux, un barbare en Asie. Des considérations sur l’Inde, Ceylan, la Chine… Tandis que je tourne les pages, la bougie se consume. Puis je me mets à écrire, et les mots brûlent comme la flamme. La nuit s’avance, la bougie reste fidèle à son poste.
Durant la journée, des coccinelles sont rentrées dans la chambre. Désormais, elles se baladent dans les draps, longent le rebord du lit, grimpent les sangles de mon sac. Intriguées par la bougie, elles cheminent tranquillement vers la table de nuit, sans se soucier de ma présence. Le sommeil vient.Demain je quitte cet endroit. Je souffle sur la flamme. L’odeur du feu reste dans l’air comme un silence après Mozart. Mes yeux se ferment. L’obscurité m’enveloppe. Au petit matin, j’entends, comme le bruit des vagues, le chant des poids lourds sur la route, qui font trembler les portes de la maison.
Je referme la grille. Elle grince comme on attend d’une grille qu’elle grince pour dire au revoir. Avec un bruit qui ressemble à des rires d’enfants. Les miens, sûrement, se cachent dans les barreaux. Rira bien qui rira le dernier.
Je tourne la clé. Une brume enveloppe le village. Un bus bientôt, paraît-il, montrera le bout de son capot. Et la vue derrière la vitre sera belle, longue et imperturbable dans le silence d’une radio matinale.
Ma maison est sur le dos. Je n’habite pas. Plus. Pas encore.
Je ne fais que passer.
Vous en êtes à la partie 2. Lire les autres autres épisodes.