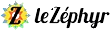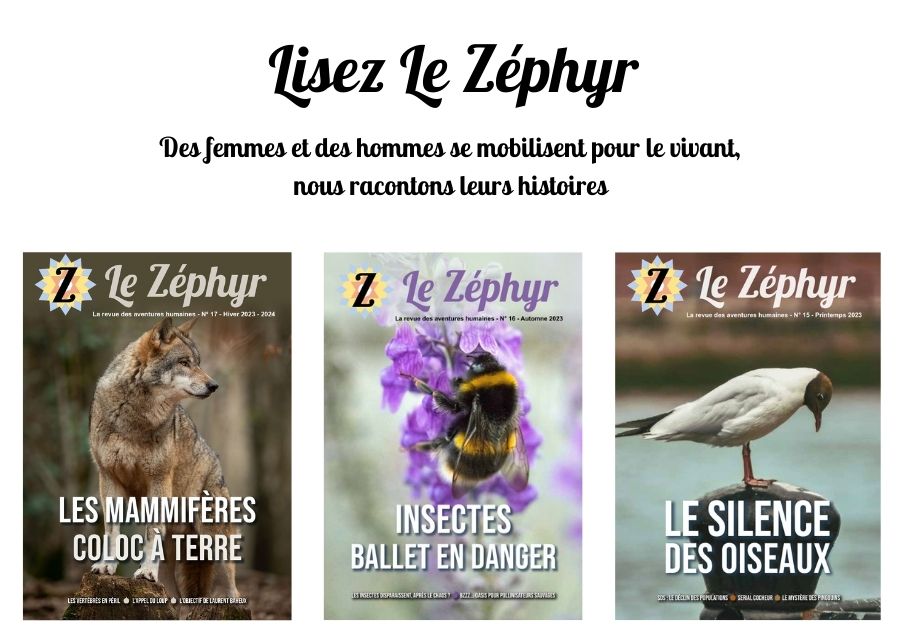Depuis longtemps, Le Zéphyr avait l’intention de se pencher sur la notion de rewilding. Une démarche visant à laisser dans un périmètre donné la nature se régénérer spontanément, en supprimant les activités humaines – ou du moins en les limitant au maximum. Le but du jeu est de restaurer les fonctions écologiques des écosystèmes, et ainsi d’obtenir à terme un haut degré de naturalité sur le site en question.
Des acteurs, ici ou là, s’y emploient, notamment pour protéger des parcelles forestières, et c’est ce que nous souhaitons étudier dans ces pages, après avoir planché sur la réintroduction animale dans le dernier numéro.
Chacun sa vision, chacun sa méthode, son cap.
Julie de Saint Blanquat a fondé l’association États Sauvages pour racheter des bouts de forêts en France (celle-ci est en majorité privée sur le territoire). Comme elle nous l’a déjà raconté au micro d’En Forêt (pour le premier numéro du podcast), elle vise à créer ce qu’elle nomme « des îlots de sénescence », des zones à l’intérieur desquels les végétaux se développent jusqu’à leur fin sans intervention de notre part. Dans une tribune, elle précise ses intentions, ses missions.
Pour l’opus, nous avons également sollicité l’ASPAS, un collectif de défense du vivant. Dans l’Hexagone, l’association crée de véritables « réserves de vie sauvage » pour laisser plus de place à la biodiversité. Il y en a de moins en moins dans nos contrées. C’est d’ailleurs tout le problème, et l’une des principales causes de la disparition des populations animales. Les habitats naturels sont détruits, morcelés au grand dam des individus de toutes les tailles. Or, au sein des réserves, l’ASPAS les laisse « tranquille », nous a-t-on expliqué.
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
Peur de l’inaction
Certains s’engagent sur le terrain. Il convient de multiplier les expériences dans les villes et les campagnes, les plaines et les montagnes, les prairies et les forêts. Situé dans la Drôme, le fonds de dotation Rewilding France lance une vaste opération au sein des Alpes du Dauphiné pour encourager les propriétaires de terrains privés, les gestionnaires ou les communes à mettre en place des actions de renaturation, en rappelant que l’humain y a toute sa place. Il n’est pas question de mettre sous cloche, nous dit-on comme pour rassurer les détracteurs.
Les craintes sont multiples. Certains ont peur de l’inaction et de la libre évolution ; il est plus rassurant de maîtriser les espaces. Pourtant, une grande majorité de citoyens se déclarent en faveur de forêts davantage protégées, comme l’a révélé l’association belge Forêt & Naturalité qui a sondé le grand public en Wallonie dans le cadre d’une étude réalisée avec l’Université de Liège. Le fondateur du collectif, le naturaliste Sébastien Carbonnelle, nous livre un long plaidoyer pour la nature sauvage.
En Gironde, les végétaux retrouvent la lumière après les feux de forêt de 2022 (lire Le Zéphyr n°19), et la non-intervention volontaire au niveau de certaines zones ravagées offre l’opportunité de découvrir comment se comporte réellement le vivant après un cataclysme. L’association Cistude Nature nous fait part de ses observations trois ans après le passage des flammes.
De façon générale, beaucoup y viennent à la libre évolution. Le WWF France en témoigne. Via le dispositif Nature Impact, l’association accompagne financièrement les propriétaires – telle la foncière forestière Cerf Vert – qui désirent protéger leur forêt. Parmi les critères retenus, il y a celui de la pleine naturalité : la structure leur demande de proscrire toute action humaine sur une petite partie du site (au minimum 5 %). « Or, beaucoup s’engagent à aller beaucoup plus loin », note Daniel Vallauri, du WWF. Preuve que les choses avancent. Lentement, mais sûrement. / Philippe Lesaffre