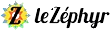Journaliste et essayiste, Jean-Laurent Cassely écrit sur la France qui vient. Et plus particulièrement sur celle des jeunes urbains créatifs et connectés, en quête de sens et d’authenticité. Un microcosme hype qui veut redessiner la France à son image… d’Épinal.
Je retrouve Jean-Laurent Cassely à Paris, dans un Prêt à Manger – la version haut de gamme des sandwicheries de centre commercial. Un non-lieu anonyme, aux antipodes de cette France authentique des p’tits bistros aux tables de Formica, qui poussent désormais comme des champignons (de Paris) et que le journaliste décrit dans son dernier essai No Fake, contre-histoire de notre quête d’authenticité (Arkhé 2019).
Ces lieux néo-urbains, juste un peu trop folklo pour être vrais (trop “authentoc” pour reprendre la formule de Technikart) le fascinent. Allons savoir pourquoi…
Lire aussi : Benoît Raphaël : « Les médias de demain seront des écoles »
Dessine-moi un bobo
Vêtu d’un combo jean-pull gris essentials, la barbe fournie mais proprement taillée, le trentenaire termine un smoothie kiwi-ananas-concombre à 4€30, tout en confirmant au téléphone sa prochaine interview avec Usbek & Rika.
À l’issue de sa semaine de promo du livre, il retournera dans le Sud. Car, après quinze années à parcourir le cœur de la vie parisienne, ce Cassidain d’origine vit désormais entre la capitale et Marseille, sa ville de coeur.
Et s’il n’était finalement qu’un provincial prompt à se moquer des snobismes du bobo parisien ? « Je n’ai aucune aversion pour les bobos, se défend-il. Par certains côtés, je crois que j’en suis un moi-même. On ne peut pas bien traiter des sujets sociétaux sans faire partie du milieu qu’on étudie… et sans s’y sentir un peu à son aise. Bon, je ne suis pas devenu un hipster, mais j’ai pris goût aux lieux hauts de gamme et confortables où ils se nichent. »
Exit donc la psychologie de comptoir (en zinc). Parlons donc de son oeuvre. Son premier livre, La Révolte des premiers de la classe (Arkhé, 2018) fut un joli succès de librairie – du moins auprès des jeunes cadres surdiplômés porteurs de Stan Smith. Ce petit manuel a inspiré toute une génération de « reconvertis » – dont mon propre boucher qui a lâché son bullshit job de contrôleur financier pour passer un CAP à 35 ans. No Fake est son second essai. Et après les avoir parcourus tous les deux, je me demande si je n’ai pas davantage affaire à un anthropologue vulgarisateur qu’à un journaliste lifestyle qu’il prétend être.
Le déroulé de son CV conforte mon intuition : fac de socio à Aix-en-Provence, DESS de com’ et sémiologie à Paris, puis master de com’ à McGill (au Québec). « J’ai commencé comme chargé d’études dans le marketing, m’explique-t-il. Juste le temps de détester ce monde du travail en open space. Comme j’adorais écrire je me suis mis à proposer des piges, notamment à Slate. J’en ai écrit une, puis 3, puis 20… et je suis tombé dans le journalisme. J’avais 30 ans. J’ai été embauché par Slate en 2012 et ils m’ont gardé. »
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
« Le Bal des Quenelles »
Lui qui n’a jamais bossé en rédaction et se désintéresse de la politique se voit alors chargé de couvrir… la campagne présidentielle de 2012.
Il préfère, plutôt, compulser les datas du CREDOC et se perdre dans les allées du salon de la franchise, où il chine « des clés pour comprendre la société française ». « J’ai mis du temps à m’avouer que ne suis pas un journaliste d’investigation : j’ai horreur d’emmerder les gens au téléphone, de leur tirer les vers du nez, de les blesser, de tremper la plume dans le plaie ».
D’ailleurs, quand on l’envoie en pleine nuit couvrir le « Bal des Quenelles » de juin 2013, dans le jardin de Dieudonné, il revient avec une aventure gonzo et second degré, déclinée dans un looong papier analytique qu’il conclut, très prosaïque, par ces mots : « L’activité protéiforme de Dieudonné et sa capacité à se placer simultanément sur plusieurs tableaux constitue un phénomène assez nouveau. » On croirait une note adressée à Monsieur le Sous-Préfet. « C’est vrai que l’aventure, c’est pas ma tasse de thé, sourit Cassely. Je ne suis pas un storyteller, ni un grand styliste. »
Je m’inscris en faux ! Cassely a du style. Mieux : il a un style bien à lui. Car, à force de singer avec malice la novlangue de la start-up nation, il est devenu bilingue. Il suffit de jeter un œil à son profil LinkedIn, qui indique que son job actuel serait « Chief Editorial Officer chez Moi-même, Région de Paris ». On sent tout de suite poindre le sarcasme.
Je parle le parisien
Mais, est-il encore au deuxième degré quand, à une question sur No Fake, il me balance, in extenso : « L’hyper France, c’est la transformation de territoires en parcs à thème de la France. C’est la digitalisation de la France analogique. Mon bouquin fait une analyse esthétique de la France périphérique et des centres-villes, transformés par la montée en gamme généralisée des aspirations. Je pointe le paradoxe d’une quête d’authenticité rurale… par des hyper-urbains qui ne l’ont jamais connue. Et je termine avec une prospective sur les imaginaires urbains. »
Tout de suite, j’avoue, je sens moins l’ironie. Mais, qu’on se rassure, le garçon n’a pas viré macronien ni techno-structuré. No Fake n’est pas si loin du dico Je parle le parisien qu’il a écrit en 2013 avec Camille Saféris. Nous sommes toujours sur une satire des tendances lifestyle du bobo francilien. Mais, avec cette grande différence que No Fake n’a rien de l’anti-manuel rigolo qu’on chope le dernier jour des emplettes de Noël, devant la caisse, à la Fnac. Désormais, ce qui n’était, au départ, qu’une bonne recette éditoriale s’est, depuis, mué en véritable passion – voire en science.
“L’ubérisation des grands-mères”
Jean-Laurent Cassely l’avoue : il est peut être un des seules types au monde à kiffer une balade dans les allées du Village Expobat, « un faux village néo-provençal installé à Plan de Campagne, entre Aix-en-Provence et Marseille. Un parc de maisons témoins, où on peut choisir sa fake villa provençale avec toit en tuiles, loggia, muret de pierre, oliviers, puit dans le jardin… »
Et quand il rentre chez Big Mamma, son cerveau s’allume comme celui d’un flic au milieu d’une scène de crime. Tout est analysé, disséqué : la burrata des Pouilles, l’accent italien du serveur… italien, la déco façon Trattoria fellinienne…
Et, entre deux travaux de prospective sur la « soc de cons’ », comme on dit à HEC, il publie, sur son Instagram, des anti-cartes postales de la “France moche” : celle des zones industrielles et des ronds-points des gilets jaunes du samedi.
Ça ne virerait pas à l’obsession un peu, parfois ? « J’adore ça! Faire des études, de l’observation, graviter entre l’univers des médias, de l’édition et du conseil. Je suis un marginal sécant. Je croise des infos. J’ai l’impression d’être parfois seul à m’intéresser à ces sujets… Aujourd’hui, ce positionnement particulier me permet de repérer des signaux faibles qui dévoilent ce que sera la France de demain. »
C’est-à-dire ? « Une vie urbaine dans un décor villageois. Le rejet de la standardisation industrielle des années 90 est, pour moi, une véritable aspiration générationnelle, qui est en train de devenir un courant culturel central. Personne n’en parle dans les médias traditionnels parce que les classes moyennes n’intéressent pas les médias – ils préfèrent se concentrer sur les classes populaires et les 1 % d’hyper-riches, ce qui peut se comprendre politiquement. Mais, du coup, on rate ce qui est devenu le centre de gravité de la société française : les “éduqués supérieurs” comme les appelle Emmanuel Todd, les 20 % qui forment l’élite de masse. »
Lire aussi : De shopping addict à coach zéro déchet : le chemin de Marion
Entre éduqués supérieurs, on se quitte là-dessus : il est 19 heures et le journaliste doit retrouver un confrère à l’autre bout de Paris, dans le 9e arrondissement. Et cette perspective l’enchante. « J’adore revenir dans ce quartier, qui est pour moi une sorte de thermomètre de l’hipsterisation de Paname. La dernière fois que j’y suis allé, je suis tombé sur trois nouveaux bistrots et deux coworking flambant neufs. C’est vraiment en train de se brooklyniser ! On m’a parlé d’un resto de burgers bo-bun authentiquement asiatiques au boeuf mariné à l’encre de seiche ! Et il faut que je teste ça ! » / Valérie Pol