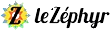Le Zéphyr donne régulièrement la parole à de jeunes auteurs. Voici Jonathan D., un ancien membre d’une ONG européenne en poste en Afrique. Il prend la plume pour conter son incroyable expérience en République démocratique du Congo. Partie 3.
Épisode 5 : Une santé, mais pas de fer
Un autre aspect important de l’expatriation en Afrique centrale concerne la santé. Et oui, j’évoquais sur un ton humoristique ma rencontre avec les moustiques, mais la réalité qui se cache derrière est bien moins amusante. Lors de mon séjour d’un peu plus d’un an en RDC j’ai eu l’occasion de faire une bonne partie du catalogue des affections tropicales. J’ai eu une indigestion carabinée qui m’a amenée jusque dans ma baignoire en pleine nuit dès mon premier mois en RDC. Pris de crampe intestinale et incapable de tenir assis sur les toilettes, il ne me resta que l’option de m’allonger dans la baignoire. Un épisode fort pénible je dois dire…
Découvrez les autres épisodes
Plus tard, j’ai eu l’occasion de faire la connaissance de Wormi, le nom du ver solitaire qui s’est incrusté dans mes intestins et pour lequel j’ai dû m’y remettre à deux fois avant d’être assuré de son éviction complète ! Je ne vous dis pas la mauvaise surprise, le jour où vous réalisez que vous avez un locataire indésirable en vous. Dans le cas du taenia (le nom scientifique de Wormi), vous découvrez des espèces de morceaux de tagliatelles dans vos sous-vêtements… Un vrai régal ! Encore tout récemment, j’ai dû me débarrasser d’une invasion d’amibes non pathogènes, mais néanmoins encombrantes, qui avaient également élu domicile dans mon système digestif.
Faiblard
Pour le coup, je peux m’estimer heureux qu’elles étaient bénignes car ces petites bactéries peuvent vous laisser un bien mauvais souvenir. Un de mes colocataires, après plusieurs années en Afrique, a tellement abusé des antibiotiques pour se débarrasser de ces cochonneries, qu’il en a désormais des problèmes digestifs chroniques et il doit souvent faire attention à ce qu’il avale. Ah, les petites joies tropicales…
À une autre occasion, j’ai été suspecté d’avoir attrapé la malaria et la fièvre typhoïde, une version forcément affaiblie, car j’avais été vacciné contre cette dernière. L’épisode en question est assez mémorable. En effet, en visite à Kisangani, je me plaignais quelque peu d’un état digestif compliqué (rien d’extraordinaire en RDC) et l’un de mes collègues pencha tout de suite pour la malaria. Je répondais sceptique et nous renvoyais à l’après-midi pour faire le point sur mon état. Toujours faiblard, et devant l’insistance de mes collègues, tout de même habitués à la question étant donné que chacun d’entre eux avait dû choper cette saleté une trentaine de fois au moins, je me décidai à me rendre au centre de santé où mes collègues congolais étaient suivis.
Bric-à-brac médical
Le moins que l’on puisse dire, c’est que ce fut une expérience rocambolesque. Le tout débuta avec une étrange conception de l’intimité puisque l’on m’amena dans un premier bureau où une mère et son enfant étaient déjà en consultation. Je me demandais si je faisais là l’expérience d’un privilège lié à ma couleur de peau, mais au lieu de passer devant la dame et son enfant, je les accompagnai ensuite dans une autre salle, comme si nous faisions partie de la même famille. Dans cette salle, on me proposa de m’assoir à côté de la mère et de son enfant qui expliquait ce qui l’amenait. Tout ça bien sûr en swahili ou en lingala, et je n’y compris rien. Enfin, rien, jusqu’au moment où l’enfant vomit un liquide blanchâtre dans ce qui ressembla quasiment à un rayon, que j’eus tout juste le temps d’esquiver en me plaquant au mur. Je décidai après cet incident de rester debout et de me tenir à l’écart. Le pauvre enfant avait la malaria et il n’était clairement pas en forme.
Lorsque ce fut mon tour, mes collègues expliquèrent brièvement ce qui nous amenait et je fus conduit en salle de prélèvement non sans passer devant tout une tripotée de personnes qui attendaient patiemment leur tour… Comment se sentir à l’aise ? En même temps, vous avez tellement envie de ressortir au plus vite de cet endroit que l’idée de s’opposer à votre passe-droit ne fait qu’effleurer votre esprit. La vue de la salle de prélèvement renforça ma conviction qu’il fallait ressortir au plus vite ! Des prélèvements en pagaye sur une table, un ou deux microscopes pour assurer la caution scientifique, des étagères ensevelies sous la poussière et un bric-à-brac médical usagé dont vous espérez que ne sortira pas la seringue qui servira à faire votre prélèvement.
Malaria
Heureusement, cette dernière sortit d’un emballage stérile tout neuf ouvert sous mes yeux. On me piqua alors le doit pour effectuer ce qui est communément appelé le test de la goutte épaisse. Probablement inspiré par cet intitulé, mon mental se mit à fantasmer la nature gélatineuse que semblait revêtir la goutte qui trônait au bout de mon indexe. Je serai fixé dans la soirée que l’on me révéla alors. Quelques heures plus tard, reçu par le médecin de la structure, celui-ci m’expliquait à l’énoncé de mes symptômes qu’un test était recommandé dans mon cas – il n’avait pas vu que son assistant lui avait glissé sous le nez mes résultats d’analyse. Positivement surpris d’abord par les précautions que nous avions prises, il fut plus circonspect à la lecture dudit papier, pas plus grand qu’un post-it. « Ahh, oui, bon vous avez la malaria et la fièvre typhoïde. » Me voilà fixé !
Trente minutes plus tard et un passage par le stock de médicament, nous étions enfin sortis pour toujours de cet endroit et j’en avais pour dix jours d’antibiotiques et trois jours d’anti-malaria. Ce qu’il faut savoir, c’est que ce genre de test n’est pas très fiable et, par précaution, on vous déclare quasiment systématiquement infecté et, comme la malaria ne suffit pas, elle est souvent accompagnée par la typhoïde… Bref, je ne saurai jamais si j’ai vraiment eu la malaria car je n’ai pas fait l’expérience de la fièvre et des joyeusetés que d’autres moins chanceux que moi m’ont décrites. Ce qui est certain, c’est que dans le doute, j’ai suivi mon traitement à la lettre.
Épisode 6 (le dernier) : Reality Check à Kisangani
Comme mon ONG avait été présélectionnée dans le cadre d’une réponse à l’épidémie de choléra qui sévissait le long du fleuve Congo, je me suis rendu à Kisangani avec un collègue pour finaliser notre proposition de projet au plus vite. Mon rôle était de m’assurer que nous écrivions une proposition en phase avec les attentes du bailleur et réaliste sur un plan budgétaire. Concrètement, j’ai animé et coordonné le travail de finalisation de la solution au cours des cinq jours dont nous disposions avant la date butoir. Le week-end a été studieux, et j’ai plus d’une fois frôlé la crise de nerf tant l’exercice était compliqué. J’espérais trouver chez nos amis du bureau de Kisangani un minimum de soutien, mais j’ai majoritairement dû leur sortir les vers du nez et tant bien que mal tenté de trouver des réponses à mes propres questions.
Ajoutez à cela le fait que je devais m’assurer de conserver un minimum les formes avec ces quatre ou cinq papas congolais de plus de 20 ans mes aînés, et vous comprenez la hauteur du challenge. Je dois avouer avoir eu quelques fois du mal à cacher mon exaspération. Mais bon, en regardant en arrière aujourd’hui, je trouve ne m’en être pas si mal sorti ! A leur décharge, ils n’avaient encore jamais travaillé à la mise en place d’un tel projet…
Casse-tête chinois
Si nous avons dû travailler dans l’urgence, c’est parce que le temps nous était compté. Il faut dire que nous étions en mai et que l’épidémie avait débuté depuis bien six mois, nous n’étions donc clairement pas en avance, et les autorités commençaient à s’inquiéter que l’épidémie de choléra ne se propage jusqu’à Kinshasa, plus loin en contrebas du fleuve. Sur la base du peu d‘informations épidémiologiques et contextuelles dont nous disposions, nous avons donc réussis à mettre au point un projet. Il concernait une bande de plus de 1 200 kilomètres de long à la topographie compliquée (peu de routes, des villages éparses, des zones inondées, etc.), dénombrant une douzaine de zones administratives de santé. Nous devions nous limiter à une allocation minuscule, alors que les besoins évoqués étaient importants et que la zone à couvrir était gigantesque. Le projet a fait appel à plus de 1 000 volontaires.
Ajoutez à cela qu’il nous fallait prendre en compte la fourniture de divers équipements par d’autres organisations et que nous n’avions aucun chiffre clair sur ce qui était disponible ou non. Bref, un vrai casse-tête et une situation loin d’être anecdotique dans le secteur humanitaire où la règle du pifomètre est souvent érigée en principe de base.
Crises oubliées
Dans le meilleur des cas, on espère toujours pouvoir réorienter le projet, une fois celui-ci démarré, après un contact direct avec la réalité du terrain. Idéalement, ce devrait être le contraire, mais en vérité les ONG ont rarement l’occasion de financer des missions de reconnaissance afin d’analyser les besoins concrets dans le milieu.
Je ne compte pas rentrer ici dans une critique ou une analyse approfondie du système humanitaire. Ce qui est clair en revanche, selon moi, c’est que c’est un milieu dont le fonctionnement imparfait s’explique par trois faits structurants majeurs. Tout d’abord, le fait de travailler dans l’urgence impose des rythmes et des contraintes qui ne peuvent pas toujours être complètement pris en compte, et ce, même si les équipes humanitaires sont très professionnelles. Ensuite, le changement régulier de personnel dans les programmes humanitaires freine l’apprentissage institutionnel, et des erreurs qui pourraient ne pas être répétées le sont probablement trop souvent. Enfin, le fonctionnement de l’accès au financement explique également pour grande partie les inefficiences du monde humanitaire.
Pour faire simple, les crises les plus financées ne sont pas forcément celles où les besoins sont les plus grands, il y a de nombreuses crises oubliées qui nécessiteraient une plus grande attention de la communauté internationale. Par ailleurs, d’un point de vue administratif, l’allocation des fonds se fait à des rythmes qui ne sont pas toujours en phase avec l’urgence et sur la base de critères qui ne sont pas toujours très transparents. Cela étant dit, je pense que cela est probablement valable pour tout autre chose, que tout ce qui relève de l’humain est toujours imparfait, et cela ne doit rien enlever aux efforts des hommes et des femmes qui s’investissent chaque jour dans ce beau métier. Et ce, parfois dans des conditions humainement et matériellement difficiles.
« Le Congo, on y revient toujours«
Cette année 2016 fut bien animée et si dans le fond j’aime mon travail dans l’humanitaire, j’avais besoin de changement. Et d’un retour au calme. Enfin, je dis ça mais parfois ma capacité à nier les évidences est assez forte et je remercierais tout de même ici ma sœur de m’avoir aidé dans mon cheminement vers ma décision de quitter le Congo. Pour être honnête, elle n’a pas eu besoin de me travailler au corps. Une ou deux conversations Whatsapp approfondies, et il était clair que ma décision été prise. Lorsque je l’ai annoncé à mon chef au Congo, il était évidemment embêté de me perdre. Mais en rien surpris. Il l’avait même senti venir…
Il faut dire que nous parlions toujours de tout. Alors il avait en effet déjà eu à voir quelques signes avant-coureurs. Le petit détail amusant dans cette histoire est cette phrase que de nombreuses personnes m’ont répétée. « Le Congo, on y revient toujours. » Eh bien, au moment de partir, je dois avouer que je n’étais pas pressé d’y retourner ! Et en attendant, à moi les vacances ! / Jonathan D.
FIN
Vous avez lu l’épisode 5 et 6 (le dernier). Découvrez les autres épisodes et l’histoire du pays