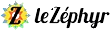Loin du tumulte des grosses productions qui ont jeté leur dévolu sur la cité phocéenne, le cinéaste indépendant Nawyr Haoussi Jones raconte son Marseille à lui.
Le réalisateur de 32 ans décrit dans ses films les difficultés de son quartier, et porte haut la voix de ceux qu’on n’entend peu.
Belsunce, au cœur de Marseille, à mi-chemin entre la gare Saint-Charles et le Vieux-Port. Ses rues exiguës, ses salons de thé aux exhalaisons envoûtantes, ses magasins de tissus, sa chaleur populaire et ses visages qui racontent tant d’histoires… Parmi eux, celui de Nawyr Haoussi Jones, familier pour qui connaît bien le quartier et reconnaissable à la casquette constamment vissée sur sa tête. Ce quartier, il y est né et ne l’a jamais quitté. C’est ici qu’a grandi sa passion, celle de raconter des histoires.
« Tout part du dessin », se rappelle-t-il. Enfant, il se plaît à retranscrire les traits d’un monde qu’il découvre peu à peu. Loin de voir cette passion s’étioler à l’adolescence, il s’y consacre plus encore. Au lycée, il troque ses crayons contre un micro. « C’était un petit rappeur, se souvient Anissa, une amie de longue date, il gribouillait des feuilles blanches. Il racontait la jeunesse marseillaise dont il faisait partie, et aussi le mal-être de la société. » Déjà, pas de fantaisie, seulement l’envie d’immortaliser des récits de vie. Par le dessin, la musique, avant que n’émerge l’idée de faire du cinéma.

« C’était un petit rappeur, gribouillait des feuilles blanches. Il racontait la jeunesse marseillaise dont il faisait partie, et aussi le mal-être de la société »
« Facteur pendant quatre ans : une expérience inspirante »
Un pas qu’il n’a pas encore franchi quand il met fin à sa licence d’histoire et entre à la Poste. En salle de tri comme au cours de ses tournées, il multiplie les rencontres qui inspireront ses futurs personnages. « J’ai nourri ma base de psychologie humaine », dit-il. Mais, derrière les personnages, il découvre un contexte social lourd. Nous sommes en 2010, la Poste est devenue Banque postale. « La hiérarchie poussait les facteurs à couper le lien social. Il y avait du harcèlement, des facteurs qui craquaient. Ça m’a heurté. » Son regard critique sur la société s’aiguise alors, en même temps que l’envie d’utiliser son art pour dénoncer.
Lorsqu’il est licencié après quatre ans et demi de courrier distribué, il a pu financer son matériel et entamer son premier film : Le Toit du monde. Le sujet : la jeunesse marseillaise. Une jeunesse aux visages multiples qui partage les mêmes interrogations sur son identité, sur son avenir, sur ce en quoi elle peut croire ou non.
___________________________________________________________________________<Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
___________________________________________________________________________
« Peu de moyens, mais une grande solidarité«
Puis les films s’enchaînent. Peu à peu, la qualité technique s’améliore, pour se professionnaliser de plus en plus. Pourtant, les moyens sont maigres. Pas de gros attirail pour les tournages. « Mais c’est une force, relativise Nawyr, cela nous permet d’aller filmer au cœur des manifestations, on peut saisir toute la hargne, ce qu’on n’aurait pas avec des figurants. »
Quant aux acteurs et à l’équipe technique, regroupés sous le label « Yes We Cannes », ils sont tous bénévoles. Cela n’empêche : « Ils sont super impliqués, reconnaît Nawyr, ils font tout pour que mes idées se réalisent. » Son frère, Nadj, qui a joué dans la plupart des films, a une explication à tant d’investissement : « Il y a une vraie convivialité. Nawyr est exigeant, mais quand quelque chose ne va pas, il le dit avec le sourire et ça passe. » Et d’ajouter : « Les thèmes abordés jouent énormément. Il parle de la réalité, il dénonce des faits sociaux. »
Deyra Manana (Merci beaucoup, en afghan) de Yes we cannes production
Raconter la vie de ceux qu’on n’entend pas
En effet, les films du réalisateur – dont les modèles s’appellent Ken Loach ou Abdellatif Kechiche – racontent « la vie des gens lambda », ceux qu’on n’entend pas, avec toujours cette portée sociale : « Je pense que je ne pourrais pas faire autrement », confie-t-il. Parmi ses thèmes récurrents, le mal-être au travail, la précarité. Des problématiques qu’il fait incarner à ses personnages, de Tony, ce professeur contractuel qui subit son quotidien, à Meva, factrice au bord du suicide qui ne trouve plus de sens dans son travail. Mais au-delà des personnages, Nawyr filme des lieux de vie, comme son quartier Belsunce dont il craint la gentrification, un phénomène qui, depuis quelques années, transforme peu à peu le centre-ville de Marseille.
« Je me rappelle la rue de la République [à moins d’un kilomètre de son quartier, ndlr]. Avant c’était hyper populaire, et puis tout a été vendu. J’ai entendu des collègues me dire que leurs parents avaient été menacés pour qu’ils quittent les lieux. » Les classes populaires ont ainsi dû déménager, souvent dans des quartiers enclavés, au nord de la ville. Elles ont laissé place à des commerces plus huppés, dont beaucoup ont depuis baissé le rideau faute de clientèle suffisante, rendant la rue glaciale pour qui l’a connue si chaleureuse.
« Un très beau regard »
« Je veux que, si Belsunce change – et je pense que ça arrivera puisque c’est ce qui se passe tout autour -, on puisse garder une image de ce qu’était ce quartier, de ses commerçants. C’est un devoir de mémoire », affirme le réalisateur. D’ailleurs, les commerçants se prêtent volontiers au jeu, fiers d’être mis en lumière, offrant de temps en temps à l’équipe de quoi se rassasier après de longues heures de tournage.
Lire aussi : Thibaut Buccellato ou les beautés du cinéma amateur.
Raconter des histoires pour créer du lien, c’est un peu le leitmotiv de Nawyr. Du lien dans le quartier, puis au moment des projections qu’il organise et qui rassemblent des centaines de personnes de tous les milieux sociaux. Mais aussi créer du lien entre le passé et le présent, entre le local et l’universel, car ce qui est imprégné dans une terre peut parler à chacun. Parler à tous, donc, avec la conviction qu’en nourrissant l’empathie et la connaissance de l’autre, « le cinéma peut changer les choses », dit-il. Redonnant ainsi du poids et de la visibilité à ceux que l’on n’entend peu, pour que, cette fois, on les écoute.