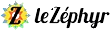Tu ferais quoi s’il m’arrivait un truc demain ? En France, onze millions de personnes répondent quotidiennement à cette question. Pour ces aidants, demain c’est loin. Beaucoup trop loin.
Il n’y a que les heures qui comptent. Celles qui s’égrainent tandis qu’on attend des nouvelles d’un proche, qu’on prépare un repas, qu’on panse une plaie ou une âme. Entre solitude et abnégation, ils portent le monde à bout de bras, comme les piliers d’un monument qui s’effrite sous leurs yeux.
Qu’y a-t-il de plus simple qu’un mot d’amour pour parler de la vie ? La vraie ? Celle pour laquelle on se bat pied à pied ? Pour laquelle on occulte jusqu’à sa propre existence ? Au fond d’un dédale de couloirs froids, une femme pianote devant un écran. Autour d’elle, s’étalent ça et là des dessins de ses enfants et des affiches vantant les nouveaux programmes du Pôle Emploi. Nous sommes dans l’une des 149 agences que compte l’Île-de-France et la conseillère qui remplit des formulaires depuis une heure est engagée dans une triple carrière.
Les yeux noirs comme une nuit sans lune, Noor parle de la force de sa fille, de la solidarité à toute épreuve de son époux, de la joie de vivre de son fils. Son petit bonhomme de huit ans qu’elle adore comme ceux que l’on aurait pu ne jamais avoir le droit d’aimer. Né à cinq mois de grossesse, l’enfant est resté de longues semaines en soins intensifs. Des semaines durant lesquels son pronostic vital a été engagé à plusieurs reprises. « Décrire les risques qu’il encourait à ce moment-là, le dire à tout le monde, c’était voir constamment dans le regard des autres que notre fils pouvait mourir. Nous ne voulions pas absorber la peur de nos proches, de nos parents, de nos amis. C’était trop. » Elle qui a préféré dissimuler son identité sous un pseudonyme pour ne pas subir les rigidités de sa hiérarchie s’exprime facilement et n’hésite pas à décrire les phases les plus délicates.
Les parents se sont donc réfugiés dans une sorte de mutisme constructif qui leur a permis de se concentrer entièrement sur l’avenir de leur enfant prématuré. « Ce n’est qu’une fois sortis d’affaire que nous avons commencé à parler. Et là, les gens se sont rendu compte de ce qu’on avait traversé. Quand on est maman d’un enfant atypique, on cumule six ou sept vies en même temps. En plus d’un métier, d’un rôle de mère et d’épouse, on devient kiné, acupuncteur, sophrologue, porte-parole. C’est parfois compliqué parce qu’on passe à côté de sa vie de couple, de pro et de femme. Mais ça donne une richesse humaine indéniable ».
Debout dès 5h30, elle part travailler une heure plus tard. Elle arrive au bureau pour une journée durant laquelle elle va enchaîner les rendez-vous avec des candidats à l’embauche, les coups de main aux collègues et les démarches pour ses propres projets. Le marathon ne s’arrête pas là et reprend même de plus belle dès 18 heures pour le retour de son fils de l’Institut médico-éducatif où il est accueilli.
Une deuxième journée commence lorsque Noor se mue en cheffe de cuisine, en institutrice, en médecin et en secrétaire de direction. Ce que l’on qualifie de charge mentale pour décrire l’accumulation de travaux effectués par les femmes et la réflexion qui s’y rapporte prend, ici, tout son sens. « Je n’ai jamais assez d’une journée pour tout faire et je reste un être humain à part entière. Il m’arrive donc de péter un plomb, de tout laisser sur place pour aller me faire une expo qui va me vider la tête. » Seule, sans enfant, sans mari, sans handicap, elle part pour quelques heures assouvir une pulsion de vie et s’accorder un instant de répit. Face au déni de soi que constitue l’aide familiale, la conscience remonte à la surface. « Quand ça se présente, il faut avoir la capacité de s’écouter. Si on ne le fait pas, on sombre et on entraîne toute la cellule familiale avec soi. »
La peur, les non-dits, les reproches, et, parfois, la culpabilité de ceux qui s’imaginent directement responsables… Plus de la moitié des couples concernés par une telle situation finissent par divorcer. Pour cette famille, un équilibre s’est installé et permet aux parents de se serrer les coudes. « On a la même vision des choses avec mon mari. Nous avons suivi toutes les étapes du traitement, participé aux rendez-vous médicaux, discuté avec les spécialistes ensemble. » Il arrive parfois que l’un des parents ne puisse endurer ce que le corps médical peut annoncer. La présence de l’autre est donc précieuse pour rendre compte des complexités et des réalités de la petite vie qui commence entre leurs mains. « Si l’un est défaillant psychologiquement, l’autre prend le relais et pose les bonnes questions. »
Cette solidité, ils l’ont forgée au jour le jour, au nom de leur enfant. Outre les questions médicales, le père du petit garçon peut s’investir pleinement grâce aux horaires décalés qu’il effectue. Travaillant à la SNCF, il enchaîne les fameux trois-huit. « Sans ces créneaux, j’aurais beaucoup plus de mal à assumer mes obligations professionnelles », assure son épouse.
Il faut parfois des années pour accepter le handicap, se pardonner la défaillance que l’on imagine dans son propre corps. En tant que mère, la démarche est encore plus difficile. On se sent coupable. Forcément coupable face à l’état du petit. Et on n’admet pas toujours de n’avoir pas su le préserver de tout ça. « Mon fils était branché à ses machines et moi j’étais branchée à lui. S’il mourait, je le suivais. » Malgré les difficultés, cette famille a su transcender cette intime blessure pour aller de l’avant pour le plus grand bien de l’enfant. Un enfant qui vit le plus normalement du monde parmi les siens. « Il est sans doute plus heureux que vous et moi. On essaie de faire le maximum pour lui. »
___________________________________________________________________________<Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
___________________________________________________________________________
Le cinéma commence à se pencher sur la thématique des aidants familiaux. Suffisant pour heurter les esprits ?
Le cinéma commence à se pencher sur la thématique des aidants familiaux. Suffisant pour heurter les esprits ?
A ses côtés, sa petite sœur joue le rôle d’éducatrice, de protectrice et d’amie. A six ans à peine, la demoiselle s’est forgé une maturité qui donnerait des complexes à plus d’un adulte. Le genre de maturité qu’on développe lorsqu’on a suffisamment de richesse intérieure pour muer le malheur en expérience. « Ma fille a gommé les différences de son frère par une acceptation totale. Ça l’embête parfois qu’il ne joue pas comme les autres. Mais toutes ces différences en font un enfant unique pour elle. Un enfant »parfaitement différent », comme elle le dit souvent. »
Avec ses petits moyens et ses grands sentiments, la demoiselle a, de facto, pris le rôle de grande sœur. Elle lasse les chaussures, commence à lire des histoires, explique les choses. Son frère est devenu le prolongement de son âme. « Ils ont cette normalité fraternelle commune à tous les enfants. »
« Si on se déclare, les choses peuvent bloquer et on peut très facilement se voir refuser une promotion »
Quand l’adversité frappe, il arrive qu’on l’enserre tout près du cœur, qu’on l’engloutisse et qu’on l’assimile. Un peu comme un arbre qui recouvrirait un éclat d’obus d’une écorce fraîchement poussée. Jamais totalement disparue, la plaie continue de ronger le tronc, jusqu’à causer sa perte. Cette conseillère a choisi une autre voie en s’engageant pour le plus grand nombre. D’ici quelques semaines, elle lancera un projet visant à permettre aux aidants de se déclarer comme tels au Pôle Emploi.
Dans cette course pour la vie, les mots sont souvent cruciaux. Nommer les choses permet de ne pas les minorer, de ne pas les oublier. L’entreprise se révèle cependant risquée au vu du système de promotion en vigueur. « Si on se déclare, les choses peuvent bloquer et on peut très facilement se voir refuser une promotion. Dans un tel cas, on va nous reverser sur une liste spéciale et nous opposer qu’en vertu du contexte familial et des absences, la promotion ira à d’autres. » Face au traitement dont ils font l’objet, cette conseillère veut que son projet fasse évoluer les mentalités et permette d’intégrer réellement les aidants dans la structure. « Les aidants existent. Notre hiérarchie le sait, mais elle n’a pas pris la mesure de la situation. Mon projet vise justement à nous donner plus de visibilité et d’humanité dans l’entreprise. »
« On ne mesure pas toujours la valeur des instants qui passent »
Les événements déferlent sur une vie comme une tempête frappe le rivage. Soudainement. Sans prévenir. Dans le petit appartement de Muriel et d’Adrien, les arpèges d’un vieux standard de Simon & Garfunkel ricochent sur les murs dépouillés. L’endroit est assez sombre et seules quelques lampes savamment disposées éclairent les rares photos de famille que le couple a laissées en évidence sur un large buffet. « Nos neveux », précise Adrien en montrant l’un des clichés.
Depuis plusieurs années, lui et son épouse ont renoncé à la parentalité. Trop de risques et d’incertitudes. La maladie dont souffre Muriel pourrait noircir les présages qui entourent habituellement un heureux événement. Craignant d’être reconnus et parfois même jugés par leurs amis, ils parlent sous le sceau de l’anonymat. En 2008, alors qu’elle court de projet en projet, la jeune femme est prise d’une sensation étrange. Comme un poids, une raideur, selon ses dires, la ralentit brusquement. Dans un premier temps, elle met naturellement ça sur le compte de la fatigue. « A cette époque, je jonglais entre trois ou quatre gros budgets. C’était un rythme de dingue, mais j’adorais ce que je faisais. Alors je ne comptais pas mes heures. »
Consultante en marketing, elle enchaînait régulièrement les nuits blanches pour boucler une présentation ou mettre une dernière main à un dossier de presse à rendre, forcément, le plus tôt possible. La raideur qui ne la préoccupait pas tant que cela a rapidement gagné du terrain, conquérant ses jambes et ses bras sans coup férir. Une invasion dont le but se dévoile dès le début des hostilités.
Les troupes ennemies, microscopiques, informes et insaisissables marchent sous une terrible bannière : celle de la sclérose en plaques. Le diagnostic est tombé au printemps 2009. Muriel venait tout juste de fêter ses 31 ans. « On ne mesure pas toujours la valeur des instants qui passent. On se contente de les regarder passer. Trois jours avant les résultats, nous buvions un verre avec des amis. Tout allait bien. Nous ne pensions même pas aux résultats du labo qui devaient nous parvenir. »
Au petit soin pour Muriel, Adrien répond le plus précisément possible et explique avec une infinité de détails les belles heures et les minutes sombres qui ont suivi. Sa « patiente », comme il l’appelle pour la taquiner, s’exprime difficilement. Dans une économie de mots, elle distille les syllabes avec la concentration d’un chef d’orchestre. Dehors, les ombres s’étirent comme de longs doigts qui se refermeraient sur le monde. Le couple n’a pas beaucoup de temps pour discuter. Quand on est coincé dans un huis clos face à une telle maladie, la vie devient une course. On se dépêche de regarder les nuages, de relire un passage de Kerouac, de penser aux autres… On se dépêche de s’aimer.
« J’ai épousé Muriel. Je l’aime et cet amour-là ne plie pas face à la maladie »
Quand les choses sont devenues « sérieuses », comme ils le disent, Adrien a mis son existence entre parenthèses. Rangés dans un tiroir, ses projets l’attendraient le temps qu’il faut. Mais le temps qu’il faut pour quoi ? « Pour s’occuper d’elle. Pour prévenir ses attentes et ses besoins. Pour lui assurer le confort qu’elle mérite », assure-t-il en souriant. Expert-comptable, il a fermé son cabinet pour adapter son activité aux contraintes de cette nouvelle vie. Désormais, Adrien enchaîne les missions en télétravail pour une auto-entreprise qu’il a lancée il y a quelques années. Autour d’eux, le petit appartement témoigne de l’effervescence qui anime leur vie.
Tout est pensé, optimisé, chamboulé, pour que Muriel puisse vivre chez elle le plus longtemps possible. Beaucoup de meubles ont été dispersés chez des proches et des amis. « Ceux qu’on n’a pas pu placer dans la famille ont fini à la benne. » La grande table en verre que Muriel aimait tant a laissé place à un modèle plus simple et, surtout, plus pratique pour circuler en fauteuil roulant. Un grand lit médicalisé trône désormais au milieu de la chambre.
Adrien, quant à lui, dort dans le canapé pour ne pas déranger son épouse. « C’est la moindre des choses, mais c’est difficile. C’est maintenant que je devrais être au plus près d’elle. Mais elle a besoin d’espace et ce lit ne convient qu’à une personne. En cas de problème, je ne suis pas loin. »
Quand on lui fait remarquer que beaucoup d’hommes auraient fui la situation, Adrien feint de s’offusquer. « Ces gens-là ne sont pas des hommes à mes yeux. J’ai épousé Muriel. Je l’aime et cet amour-là ne plie pas face à la maladie. Si j’étais à sa place, elle s’occuperait de moi. Alors, je suis là pour elle. C’est aussi simple que ça. »
Malgré sa détermination, il se sait épuisé. Il ne l’avouera jamais devant elle, mais il lui arrive de craquer quand il est seul. « Ce n’est pas évident d’expliquer ça à quelqu’un qui ne vit pas ce genre de choses, dit-il en aparté. On pourrait prendre ça pour de l’égoïsme, mais cette maladie, même si elle ne me menace pas directement, me condamne aussi. » Comme nombre d’autres aidants, Adrien a renoncé à exister pour faire face à l’érosion qui menace l’amour de sa vie. S’il balaie d’un revers de main les scenarii l’envoyant dans un quelconque paradis de quiétude, il n’oublie pas que cette précaire subsistance est loin du projet qu’ils s’étaient fixé.
Avec le temps, on peut se faire à beaucoup de choses. Les nuits blanches et les courses urgentes, les privations et le système D, les difficultés et la mine renfrognée des docteurs… tout y passe. Mais personne ne peut s’habituer à la désagrégation d’un visage. « On n’est pas programmé pour ça », précise Muriel, qui semble acquiescer au discours de son époux. Au quotidien, leur vie se résume en un balai incessant de kinés, d’auxiliaires de vie, de prises de médicaments et de gestes pénibles. Est-il possible de préserver une part d’intimité et de complicité dans de telles conditions ? « C’est essentiel », assure Adrien. « On a une relation plus simple, désormais. Notre vie conjugale a laissé place à un rapport d’affection et de protection. C’est sans doute ce qui se rapproche le plus de l’amour, au final. Quand on a renoncé au sexe et à la fougue, il reste les sentiments. Il reste l’essentiel. »
Aux caresses de jadis ont succédé les regards, les mots, les attentions dont aucune personne extérieure à ces murs ne saurait comprendre la portée. On pourrait croire que le petit deux-pièces qu’habite le couple depuis treize ans se transformerait peu à peu en mausolée, mais il n’en est rien. Pierre après pierre, obstacle après obstacle, Muriel et Adrien en ont fait une forteresse d’où ils ripostent face aux assauts du temps.
« Toutes les mamans sont des héroïnes aux yeux de leurs enfants »
A quelques stations de là, une femme se bat seule. Lorsque l’on discute avec Valérie, la première question est invariablement destinée à sa maman. Comment va-t-elle ? Où en-est la progression de sa maladie ? Et les traitements ? Sont-ils efficaces en ce moment ? Depuis près de trois ans, cette journaliste culturelle vit pour sa mère et veille à ce qu’elle ne manque de rien. Rose est atteinte du même syndrome que Catherine Laborde, l’ex-présentatrice de la météo de TF1. Détectée pour la première fois au détour des années 1990, la maladie à corps de Lewy (MCL) est une affection neurodégénérative complexe qui touche plusieurs parties du cerveau et dont l’évolution est souvent variable. A mesure que le temps passe, elle réduit l’autonomie et les fonctions cognitives des personnes atteintes à leur plus simple expression.
« Ma première préoccupation, c’est de trouver les bons interlocuteurs. Il faut constamment ouvrir l’œil, s’assurer que les traitements sont bien évalués en fonction des besoins de ma mère. C’est un parcours du combattant et une lutte de tous les instants. » Malgré le fait qu’elles vivent à Paris, Rose et Valérie se sont très tôt heurtées à une réalité. Même dans une métropole au rayonnement mondial, les vrais spécialistes se font rares. « On me rétorque souvent qu’il n’y avait strictement rien dix ans plus tôt. Malgré les associations et les collectifs, ça reste insuffisant. Si on n’a pas la chance d’être accompagné par une structure privée, on tombe inévitablement dans le public. »
Au sein même des établissements hospitaliers, les services sont insuffisamment préparés pour faire face aux besoins si spécifiques de Rose. Sa maladie, que l’on peut décrire comme un mélange d’Alzheimer et de Parkinson, n’entre pas dans les cases classiques et l’octogénaire se retrouve catapultée dans les unités psychiatriques. Pour une personne atteinte d’un tel syndrome, la solution est souvent pire que le mal. Isolés au creux de leur esprit, ces patients sont sujets à des montées d’angoisse et sont rapidement terrorisés.
« Ma mère et moi sommes sorties de cette première expérience catastrophées. Il n’y avait que de la souffrance là-bas. Par chance, elle est désormais suivie par une clinique privée. Ça m’a sauvée. » Chaque année, des centaines de personnes souffrant des mêmes symptômes sont dirigées vers les services psychiatriques faute de temps, de moyens ou de personnels.
« Toutes les mamans sont des héroïnes aux yeux de leurs enfants. La mienne a disparu. Elle me manque. » Face à la progression de la maladie, Valérie s’est découvert des forces, une détermination, un but. On ne devient pas aidant par choix, selon elle, on le fait par devoir. « C’est comme si nous avions un nouveau-né à la maison. On bascule dans ce système très rapidement. Ça prend toute la place et on doit se réadapter à marche forcée autour de cette charge. » Peut-on s’habituer à tout, dans un tel contexte ? L’extinction physique et intellectuelle d’une mère qui appelle désormais sa fille « Maman », la privation de la relation qu’entretenaient naguère les deux femmes, sont autant de pierres que Valérie porte sur son dos.
Après trois ans de combat en solitaire, elle a tout de même remporté une victoire majeure. Malgré les conseils des spécialistes et des services publics, Rose vit loin des Ehpad et des centres hospitaliers. Pour la seconder, sa fille a fait appel à des relayeurs pendant une période. Mais sans garantie, il faut parfois prendre des risques. « Nous sommes tombées sur un escroc fiché par la police. Au bout de quelques temps, il a laissé maman à terre et nous a dérobé 13 000 euros. »
En quelques années, Valérie a dressé un bilan alarmant de ses observations. « On tourne en rond comme des poissons dans un bocal », selon elle. La reporter pointe notamment du doigt les lacunes politiques de la France face à ce qui se fait au Canada ou en Europe. L’Allemagne compte près de 30 000 places d’hébergement solidaire. Un exemple que Valérie voudrait voir appliqué dans l’Hexagone. Elle tente actuellement de monter un projet analogue qui permettrait à des familles vivant la même situation de s’engager ensemble, d’investir une maison ou un appartement, de partager les dépenses, et de s’occuper de leurs proches. Une sorte de « colocation Alzheimer », comme elle la décrit, qui permettrait d’éviter l’isolement et l’inquiétude d’un placement dans un centre plus ou moins adapté.
« Il y a plein d’appartements vides à Paris. Les familles pourraient payer, s’engager dans un tel projet. Mais les choses ne se mettent pas en place et je pense que c’est un manque de volonté des pouvoirs publics. » Que faire de Rose en attendant que le projet fleurisse ? A bout de force, sa fille ne supporte plus ces jours où, contrainte, elle s’oblige à la confier à une clinique. « Ces jours-là, quand je vois ses yeux de l’autre côté de la vitre qui semblent me demander pourquoi je la laisse, je craque littéralement. Ce n’est pas évident de voir sa mère prostrée vous implorer, vous supplier même, de la ramener à la maison. »
« C’est très difficile de tout gérer de front. J’ai dû refuser des projets car j’aurais eu l’impression de ne pas les mériter »
Les aidants ne sont pas les seuls à voir leur vie basculer. Dans leur sillage, les proches, les amis, les enfants pâtissent de la situation. La fille de Valérie a 15 ans. A cet âge, on se pare souvent d’une solidité de façade pour ne pas laisser transparaître les fêlures de la vie. Coupée de sa mère et de son enfance du jour au lendemain, la jeune fille a sombré dans une dépression. « Elle est restée près d’un mois et demi seule à la maison. Elle avait treize ans. Et même si elle m’a dit que ça lui avait permis de devenir plus autonome, je sais qu’elle a souffert », assure Valérie. Privée de son équilibre, elle a même souhaité voir sa grand-mère mourir. Un cercle vicieux, une spirale de l’enfermement et de l’isolement… Voilà ce que vivent ces trois femmes. Rose sombre dans la maladie. Valérie se heurte au silence et à l’incompréhension de ses proches. Sa fille, enfin, doit se construire une identité et une vie loin de ses repères.
Sa carrière, Valérie l’a mise entre parenthèses. Être journaliste, devoir partir sur le terrain, cultiver son réseau et vivre, en parallèle, le quotidien d’un aidant est une mission à haut risque. Après une courte période durant laquelle elle a enchaîné les piges et quelques missions de relations presse, elle a finalement pris ses distances avec son métier. « C’est très difficile de tout gérer de front. J’ai dû refuser des projets car j’aurais eu l’impression de ne pas les mériter. Je n’étais tout simplement pas capable de les mener à bien. »
Au fil du temps, la situation de Valérie se complique. Quand on devient aidant, on s’oublie. On s’évanouit dans un lit de hasard et de contraintes. Comme les millions d’autres personnes dans son cas, Valérie a fait abstraction de sa propre condition et doit à présent rattraper le retard. « Le travail, ça devient urgent. Et je dois également voir des médecins. » Tenir bon, en attendant de trouver cet équilibre tant espéré. Voilà la ligne de mire de cette famille.
Au-delà de la résilience dont elles font preuve, c’est de soutien dont ces familles ont besoin. Un soutien immédiat, logistique, matériel, concret. Mais un soutien qui arrive, généralement, au compte-goutte. Pire, certaines dispositions confinent à l’absurde. Ainsi, l’allocation personnalisée d’autonomie (APA) visant, en théorie, à aider financièrement les personnes concernées les transforme finalement en patrons de PME unis à leurs aidants par les liens sacrés du droit fiscal. A la tête d’une véritable « petite entreprise » ayant pour seul et unique objet de garantir leur confort et leurs soins, ces « patrons » doivent « effectuer toutes les démarches liées à ce statut : contrat de travail, déclaration à l’Urssaf, versement du salaire », comme le précise le site d’Humanis, un des acteurs majeurs du secteur mutualiste.
Mais que les aidés se rassurent ! La même source ajoute que le recours au Cesu (une offre de déclaration simplifiée proposée par l’Urssaf) facilite toutefois les démarches : « L’employeur n’a pas à établir lui-même les fiches de paie de son salarié, ni calculer les charges sociales à verser à l’Urssaf. » Un argument qui n’atténue pourtant pas le caractère contraignant du dispositif. Thérapeute, kiné, infirmier… L’aidant doit, en vertu du dispositif, assumer des tâches administratives. Une contrainte supplémentaire qui oblige beaucoup de monde à renoncer purement et simplement à l’APA.
Selon que l’on vive en région parisienne ou au fin fond de la Creuse, la notion d’assistance revêt des enjeux totalement différents. Pour l’heure, la loi stipule que les aidants peuvent s’absenter de leur poste pendant trois mois. Durant cette période, il leur est formellement interdit d’exercer une activité complémentaire, si ce n’est au service de l’aidé, comme précisé dans le cas de l’APA.
Seules des dispositions particulières permettent aux aidants de s’absenter plus longtemps, mais ces derniers ont un impératif incontournable. Au cours de leur carrière, les salariés ne peuvent prétendre à un tel droit pour une durée supérieure à un an. Ce qui ne correspond clairement pas aux contraintes que rencontrent les familles. « Si j’avais dû faire appel à ce dispositif, je n’aurais tout simplement rien pu faire. Ma femme aurait été hospitalisée et je l’aurais tout à fait perdue », assure Adrien.
Comme lui, nombre d’aidants se livrent à un véritable numéro de funambule pour faire face. Selon une étude publiée en mai 2016 par l’association France Alzheimer, 44 % d’aidants déclarent piocher dans leurs congés payés et leurs RTT pour s’occuper de leurs proches. Un chiffre qui illustre la double peine d’une vie d’aidant. Au-delà des perturbations dans leur carrière, ils se voient progressivement privés de périodes si précieuses pour se ressourcer, souffler ou tout simplement penser à soi.
Constamment sur la corde raide, les aidants doivent parfois parcourir des distances considérables pour s’occuper d’un proche. On estime qu’en moyenne 226 kilomètres les séparent. Cette statistique illustre l’urgence vitale de trouver sur place des interlocuteurs qui pourront seconder les familles. En cela, le vote de la « loi Pour un État au service d’une société de confiance » (ASV) survenu le 31 juillet 2018 a sans doute ouvert la voie à une expérimentation inédite basée sur un concept canadien.
Outre-Atlantique, des hommes et des femmes se mettent à la disposition des familles pour se substituer aux aidants. Face à l’épuisement des personnes souvent usées par des années de lutte, ces baluchonneurs les remplacent, s’occupent de l’essentiel, assurent le bien-être et la sécurité de l’aidé et offrent aux aidants la possibilité de prendre de la distance pour quelques jours. La loi prévoit ainsi une période de test de trois ans durant lesquels les familles pourront faire un pas de côté et s’affranchir de certaines dispositions du code du travail tricolore avec un objectif clair : accorder le droit à un même intervenant de rester plusieurs jours au domicile d’une personne âgée dépendante.
« C’est un engagement et une responsabilité de tous les instants »
Dans sa petite maison blottie au cœur d’un vallon mosellan, Dominique prend soin de son père François. A 87 ans, il reste figé dans un demi-sourire en attendant que le jour tombe à son tour. L’AVC foudroyant qu’il a subi voilà deux ans l’a laissé là, prostré dans un geste avorté. Son grand fauteuil de velours vert et ses effets personnels ont remplacé les meubles design que sa fille aimait tant. Pas la place de tout accumuler. Et puis ce ne sont que des meubles, concède-t-elle en souriant. Pour l’épauler, Dominique fait appel à Marie-Anne. Cette ancienne infirmière libérale a récemment franchi le pas et se consacre désormais à une seconde carrière.
« C’est un engagement et une responsabilité de tous les instants. Quand on devient relayeuse comme moi, on se met à la disposition d’inconnus. On écoute et on va au devant de leurs besoins. Et ça me semble très naturel, vu le métier que j’exerçais. »
Depuis quelques mois, elle vient ponctuellement en aide à Dominique dans ses démarches quotidiennes. Assurer la toilette, aider pour les déplacements, préparer quelques repas et s’assurer que François ne manque de rien… Autant de gestes évidents qui, mis bout à bout, forment une journée entière, une vie même. Une vie à travers laquelle rien ne peut passer. Ni la lumière, ni la voix des amis les plus fidèles.
Pour la petite famille, l’arrivée de Marie-Anne est une aubaine inespérée. « C’est elle qui est venue nous voir. Elle avait entendu parler de notre situation dans la bourgade où nous vivons et s’est tout simplement présentée », se rappelle Dominique. Tout d’abord sceptique, elle s’est finalement laissée convaincre en discutant avec l’ancienne infirmière. Et tout se passe très bien, selon elle. Si le dispositif a été validé par l’Assemblée nationale durant l’été, des porteurs de projet s’engagent depuis une dizaine d’années à l’échelle locale. Ainsi, l’association Bulle d’Air a accompagné 210 familles en 2017. Au total, ce sont près de 48 000 heures de présence et de soutien qui ont été assurées par les 250 relayeurs de la structure. Majoritairement composées de femmes, ces équipes s’appuient sur de nombreux retraités du secteur médico-social. D’anciens aidants, parfois animés par le désir d’arrondir leurs fins de mois tout en faisant profiter de leur expérience, se lancent également dans l’aventure.
Dans les bureaux comme dans les ateliers, une omerta matinée de marketing forme une chape de plomb sous laquelle l’aidant ne peut s’exprimer. Le taux de bonheur au mètre carré semble désormais occuper les rêves et les pensées des managers du monde entier. Et cette course au sourire ne saurait être contrariée. Spécialiste des ressources humaines, Sandrine Virbec a soutenu l’un de ses collaborateurs face à ce système. Alors en charge du service paie d’un groupe spécialisé dans le service aux entreprises, ce dernier s’occupait en parallèle de sa mère grabataire. Une situation qui l’obligeait à demander régulièrement des aménagements de planning ; des aménagements dont il taisait évidemment l’origine. « Je ne sais pas s’il s’agissait d’autocensure, mais il n’a jamais directement soulevé le problème », assure Sandrine Virbec.
« Il a dû assurer l’organisation complète d’une petite équipe chargée de s’occuper de sa mère en journée. Cela suppose des déplacements et une logistique. Et ce n’est qu’à ce moment-là qu’il a trouvé les mots pour m’en parler. » Même avec un discours libre et une ouverture d’esprit totalement assumée, elle précise qu’il est difficile d’aborder ces questions au sein de l’entreprise. Comment trouver les mots ? Comment s’affranchir de la pudeur et du respect de l’espace privé d’autrui ? Comment, enfin, aller au devant de besoins qui ne sont pas exprimés ? Au fil du temps, Sandrine et son collègue ont pu vaincre l’inhibition qui les bloquait. Son planning a été entièrement repensé pour lui permettre de mener de front l’ensemble de ses obligations.
« Se pencher sur les besoins spécifiques de chacun, c’est également s’ouvrir aux critiques. Et ça, pas mal de managers ne l’acceptent pas encore »
A une époque où « le bonheur en entreprise » fait l’objet d’un véritable culte, les problèmes d’un aidant dénotent avec le portrait parfois idyllique que l’on dresse d’une structure en pleine ascension. Être heureux envers et contre tout, faire une partie de baby-foot dans l’open-space, partager un brunch sur les bancs d’une cafèt’flambant neuve, discuter avec son happiness manager : des dérivatifs dérisoires face aux situations que certains vivent dans un silence absolu.
Nommer les difficultés et les décrire avec précision permet de les affronter. Il y a quelques années encore, le terme d’aidant familial n’avait toujours pas pénétré les épaisses murailles du monde de l’entreprise. Pourtant, dissimulé à l’ombre des sourires et des poignées de main, la souffrance des uns ricochait dans l’air. C’est avec la force des exemples et des initiatives individuelles que l’on fera école, selon Sandrine Virbec.
Des exemples qui doivent transcender les interdits et dépasser les impératifs marketing et le diktat du sourire. « On est constamment face à une espèce d’exaltation du bonheur au travail. En entreprise, être heureux devient une obligation sous peine d’être suspecté de ne pas être en phase avec »l’esprit » de la boite. » Dans ce contexte, toute envie de s’exprimer librement risque d’être annihilée à ses yeux.
« Se pencher sur les besoins spécifiques de chacun, c’est également s’ouvrir aux critiques. Et ça, pas mal de managers ne l’acceptent pas encore. » Ancien responsable administratif d’un groupe audiovisuel, Gérard B. a vu plusieurs collègues sombrer dans une profonde dépression au détour d’une réorganisation apparemment banale.
Interloqué par l’effet « disproportionné » de ce changement, le quinquagénaire a tenté d’en savoir plus auprès de ceux dont il était le plus proche. « Il m’aura fallu plusieurs jours de négociation pour que l’un d’eux me parle finalement. Lui comme les deux autres étaient tous aidants familiaux. Des situations compliquées, inextricables même. L’un d’eux s’occupait de son fils malade. Les deux autres soignaient un parent. Avec le recul, je m’en veux énormément d’avoir pris leur déprime pour un refus d’évoluer. »
Cet effet disproportionné, comme l’évoquait alors Gérard B., était à la mesure des complications engendrées par les nouveaux plannings du service. Sans information concrète, il n’a pu intercéder en leur faveur qu’au bout de plusieurs semaines. Trop tard pour revenir en arrière. Malgré une demande officielle et l’intervention des représentants du personnel, aucun aménagement n’a été proposé aux personnes concernées. « Ici, on ne fait pas dans le sur-mesure », avait répondu le manager à l’un d’eux.
Depuis quinze ans, Sandrine Virbec explore les questions de relations sociales et de diversité dans de grandes entreprises. Pour elle, tout est affaire d’empathie. « Chercher les causes d’un trouble, aller à l’encontre des apparences et des sourires de façades, c’est avant tout investir dans l’humain. »
Dans un monde où il faut impérativement montrer son meilleur visage, la première urgence serait de démontrer à tous les managers l’intérêt qu’ils trouveraient à ouvrir la porte au dialogue. En Finlande, 95 % des salariés aidants s’identifient auprès de leur DRH. En France, seuls 5 % font la démarche. En cause, l’absence quasi totale d’écoute, d’outils et de procédures au sein des entreprises tricolores. « On peut imaginer tous les programmes possibles, voter des lois par dizaines, lancer des campagnes de sensibilisation. Si les managers ne sont pas convaincus que l’entreprise profiterait directement de la prise en compte des aidants familiaux, rien ne se fera », assure-t-elle en insistant sur le fait que c’est tout un état d’esprit qu’il convient de changer. Loin des mesures coercitives et des systèmes de quotas pouvant être imposés par l’État, le sur-mesure que refusait le supérieur de Gérard B. il y a quelques années serait, finalement, la clef.
Claudie Kulak se considère comme une aidante parmi d’autres. Peut-être l’est-elle, effectivement. Mais son parcours personnel et la manière dont elle a su transformer les épreuves en sources d’espoir en dit long sur son caractère. Lorsqu’on lui demande ce qui l’a poussée à créer La compagnie des aidants, elle répond sans détour. « C’est l’amour et la colère qui m’ont incitée à le faire. »
Pendant plusieurs années, elle a soutenu deux proches. Son père était atteint de la maladie d’Alzheimer et sa tante est devenue dépendante à cause d’un accident domestique. Gérer de front une carrière, une vie d’épouse et de mère, tout en s’occupant de deux personnes au fil de l’eau… Il est peu probable que l’on trouve une telle histoire crédible si elle est un jour transposée sur grand écran. Et pourtant… Claudie Kulak l’a fait.
« C’est au début de l’année 2011 que j’ai réellement pris conscience de la réalité d’un parcours d’aidant. Je cumulais plusieurs vies dans une journée. J’étais seule et fatiguée. J’avais juste envie de dire merde et de tout laisser tomber. » Face à sa conseillère sociale, la quinquagénaire a craqué.
« Je lui ai dit que je n’en pouvais plus, que j’avais besoin d’aide et que j’allais crever. Elle m’a tout simplement répondu : « Bienvenue parmi les aidants Claudie. » » Femme de projets, elle n’a pas baissé les bras et s’est nourrie de tous les récits et des expériences les plus diverses pour lancer son association. Une initiative saluée par le jury du tout premier Forum de l’économie sociale et solidaire qui en a fait, à la fin de cette même année, sa lauréate.
« La France est un pays sans aucune forme de pédagogie concernant la perte d’autonomie, la fragilité, le handicap, l’isolement. »
Dans les premiers temps, Claudie Kulak a perçu de la méfiance chez ses interlocuteurs. « Le monde du médico-social est très suspicieux. Les assistantes sociales et les conseillers m’ont prise pour une intruse. Ils avaient peur que je vole leur travail. »
Elle a dû se montrer persuasive et pédagogue pour leur prouver que les outils de La compagnie des aidants étaient pensés pour les seconder et non les remplacer. « Cela dit, je les comprends. Tous les jours, des petits malins frappent à leur porte pour présenter l’invention du siècle, l’idée qui supprimera tous les problèmes. C’est une illusion et ça forge la réticence. »
Face à ce déferlement d’inventeurs plus ou moins inspirés, la présidente de l’association pense qu’il faut accompagner les acteurs du secteur en les connectant aux nouvelles technologies, en leur faisant prendre conscience des options dont ils disposent. Dans un contexte où une personne sur deux sera, un jour ou l’autre, confrontée à une forme de handicap, l’urgence de la structuration et de la concertation est absolue. Un propos que confirme Émilie. Assistante sociale de 30 ans, elle officie dans l’Aude depuis trois ans et ne sait pas toujours quoi répondre aux gens qui la sollicitent.
« Au quotidien, c’est parfois difficile d’apporter une aide concrète quand on ne sait pas ce qui existe entre les programmes publics et les acteurs associatifs. » Au-delà, les particuliers sont également démunis face à la complexité des procédures. « Il y a une fracture sociale. Beaucoup de gens ne remplissent tout simplement pas les dossiers parce qu’ils ne comprennent pas les questions qui leur sont posées », selon la fondatrice de La compagnie des aidants.
Comme les assistants sociaux, les aidants manquent cruellement d’information. Après sept ans d’engagement au sein de sa structure, Claudie Kulak dresse un constat alarmant. « La France est un pays sans aucune forme de pédagogie concernant la perte d’autonomie, la fragilité, le handicap, l’isolement. » Au-delà des lacunes et du silence, les gens vivraient dans l’illusion de l’éternité et de l’invulnérabilité, selon la porteuse du projet.
Dans son Voyage au bout de la nuit, Louis-Ferdinand Céline estimait que le fait « d’évoquer sa prospérité future, c’est faire un discours aux asticots ». Extrait du contexte de la grande guerre et des envolées rageuses du romancier, l’idée reste en vigueur. D’après les Maisons départementales des personnes handicapées (MDPH), on estime que 12 millions de Français sont porteurs d’un handicap, dont 80 % sont invisibles. Pour la responsable associative, nous sommes dans une société du déni de la difficulté.
Également présidente du collectif associatif Je t’aide depuis 2017, Claudie Kukak voit tout de même une lueur d’espoir. En quelques mois , le nombre de Français s’identifiant en tant qu’aidants est passé de 20 % à plus de 40%. Grâce à l’instauration de la journée nationale des aidants et la contribution de certains DRH, le taux d’information augmente notablement.
Pour accompagner cette dynamique, La compagnie des aidants a aménagé un bus entièrement dédié à la sensibilisation du public et l’a tout simplement garé sur le parvis de la Défense. A bord, des membres de l’association et des assistants sociaux ont accueilli des salariés aidants ainsi que des DRH et des chefs d’entreprise pour leur expliquer concrètement l’envers du décor et les outils mis à leur disposition. L’expérience devrait être renouvelée en 2019 avec un tour de France des hôpitaux au cours duquel le public pourra échanger avec des professionnels et se confronter à la réalité tout en oubliant certaines légendes urbaines encore tenaces. La première réside dans la perception que l’on a des services à la personne.
« Ce sont tout sauf des bonniches. » Les personnes qui s’engagent dans cette voie acquièrent des compétences, font preuve d’un savoir-être précieux pour les entreprises. Pour Claudie Kulak, ça ne fait aucun doute. Elles sont indispensables. « Les personnes que j’ai embauchées pour me seconder ont été formidables. Sans elles, je ne serais sans doute pas là pour en parler », estime Claudie Kulak.
Lire aussi : Bienvenue chez les zèbres : l’étonnant quotidien d’une famille de surdoués
Comme Claudie, Adrien, Valérie et tant d’autres, les aidants font œuvre de résilience face aux événements qui les bousculent. Sans aide significative des pouvoirs publics, ils gèrent jour après jour des vies qui ne leur appartiennent pas. / Jérémy Felkowski