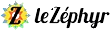Monteur vidéo le jour (pour Oh my goal), réalisateur la nuit. À 27 ans, Nicolas Khamphosa trace sa route. En 2018, l’Yvelinois a sorti un court métrage sur le harcèlement de rue, Demain, peut-être. Un mini film « coup de poing », qui refait parler de lui depuis quelques jours, deux ans après avoir été primé au Mobile film festival.
Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
Chaque année, le Mobile film festival demande aux participants d’envoyer un film d’une minute, tourné avec un smartphone. Et ce, sur une thématique précise. Pour l’édition 2020, il s’agit du « women’s empowerment » et, à l’occasion, le festival a « remis en vitrine » Demain, peut-être, qui cartonne, du coup. « Je ne m’y attendais pas », sourit-il, ravi de voir le compteur de vues s’affoler. Le Zéphyr a rencontré le jeune cinéaste, qui veut aller loin.
« Réaliser un film sur le harcèlement de rue qui parle à tout le monde »
Pourquoi avoir traité ce sujet du harcèlement de rue ?
En 2018, j’ai participé au mobile film festival, qui demandait des scénarios autour de la question des droits de l’homme. Alors, j’ai cherché un sujet qui pouvait me toucher. Pourquoi le harcèlement de rue ? J’ai une amie qui avait été agressée deux ans auparavant, en 2016. Verbalement et physiquement. Alors, ça m’a paru intéressant de réaliser un court métrage sur cette thématique.
Je ne dis pas que je n’aurais pas raconter cette histoire-là si cela n’avait pas été une copine proche. Mais, forcément, quand cela arrive à une bonne amie, on y est logiquement plus sensible. Je lui ai demandé si cela lui dérangeait si j’évoque, au travers d’une fiction, son histoire, au moins en partie. Et elle a accepté.
Que vouliez-vous montrer, concrètement ?
J’ai discuté avec d’autres femmes qui ont subi ce type de violences, pour m’imprégner. Je voulais réaliser un film coup de poing, qui parle à tout le monde. Pour y parvenir, j’ai choisi de mettre en scène une femme dans sa chambre.
Elle est seule, s’habille et se maquille. Mais elle imagine tout ce qui pourrait lui arriver à l’extérieur, sur son chemin. Alors, elle décide de se raviser, change de vêtements et quitte le domicile.
La première séquence qu’elle imagine, dans un parking, fait écho à ce qui est arrivé à mon amie. J’ai ajouté deux autres « scènes » auxquelles pense l’héroïne. Il se trouve que j’apparais dans l’une d’entre elles.
Cela me permet de revenir – indirectement – sur mon propre passé, au cours duquel j’ai pu, à certains moments, être un peu trop lourd. Vous savez… un jeune, âgé de 18-20 ans, qui veut draguer une fille qu’il trouve jolie, et fait le con…
Donc c’est une façon de faire votre mea culpa ?
J’étais jeune, un peu bête, et je ne me rendais pas compte que ce type de comportements pouvait s’apparenter à du harcèlement. Il faut le reconnaître, puis sensibiliser.
Le cinéma thérapeutique
Comment votre amie a-t-elle perçu le film ?
Elle l’a vu avant qu’il sorte, cela était indispensable à mes yeux. Forcément, le visionnage a dû la glacer, ce n’est pas évident de se replonger dans ses souvenirs… Mais elle a bien aimé le court.
Vous avez réalisé plusieurs courts métrages. Vous souhaitez à chaque fois vous engager ?
Je choisis des sujets qui me tiennent à cœur. Qu’ils soient sensibles, ou non. En tant que réalisateur, j’ai une possibilité de raconter l’histoire de mes proches et de les mettre en image. Il y a toujours un parallèle avec ce que j’ai vécu. Le premier court réalisé traite du monde du football amateur à travers l’exemple d’un joueur du FC Mantois. Pendant longtemps, j’ai joué au foot et espérait passer pro. Et mon meilleur ami était en négociation pour signer son premier contrat.
À 19 ans, je souhaitais démarrer dans le cinéma, lui dans le foot. Et j’ai voulu établir un parallèle entre les deux situations. Ce n’est pas un sujet sensible, mais je parle de moi. C’est le premier court : Ils y croiront jusqu’à la dernière seconde (2014), malgré certaines erreurs de débutant, j’en garde un bon souvenir.
Vous vouliez devenir footballeur ?
J’ai longtemps joué et me suis blessé au genou, pendant quatre mois. Ce n’est pas une longue période d’absence, mais je n’ai plus eu la motivation pour repartir. J’avais des facilités, mais n’étais pas un gros bosseur, je n’avais pas la niaque pour me dépasser, je ne voulais pas faire trop d’efforts. Et cela a été l’inverse pour le cinéma.
Là, aucun souci. La détermination, je l’ai toujours eu. Finalement, j’ai dû davantage vouloir être réalisateur que footballeur, même si la passion reste forte.
Après le documentaire sur le foot amateur, vous avez donc continué à traiter des sujets intimes ou personnels ?
Dans les deux suivants, j’ai voulu me concentrer sur mes parents, avec qui j’ai eu un rapport conflictuel. D’abord, Jeanne (2015), sur le pardon, suit un prisonnier qui s’évade pour se rendre au cimetière et rendre hommage à sa mère décédée. Ma mère n’est pas morte, c’est une métaphore : je m’interroge sur ce que j’aurais pu faire si je l’avais perdue. Une manière de m’excuser et de lui montrer que je reconnais avoir été un enfant difficile, ayant fait beaucoup de conneries. Lui dire que parfois les mots nous manquent – même un « je t’aime » peut paraître difficile à dire. C’est bête, hein ? Ce film a servi à me réconcilier avec ma mère.
Et il y en a eu un autre. Joyeux anniversaire (2017). Un court sur l’adultère de mon père vis-à-vis de ma mère, je raconte comment je l’ai ressenti, plus jeune.
C’est thérapeutique alors de tourner des films ?
Oui c’est ça. Via un film, avec les images, le réalisateur s’exprime quand il ne peut le faire avec les mots… Le court sur le football, c’est en quelque sorte pour exprimer mes regrets, car je n’ai sans doute pas assez donné pour devenir footballeur. Demain, peut-être c’est pour dire – entre autres –que mon comportement a pu laisser à désirer. Avec Jeanne et Joyeux anniversaire, j’ai pu m’adresser à mes parents. Réaliser ces deux films m’ont permis d’avancer. Jeune, je ne m’intéressais qu’au foot et au montage vidéo. Je n’en faisais qu’à ma tête.
Comment percer dans le cinéma ?
Difficile question. Y a le talent, la chance, le piston. Il en faut. Or, pour réussir, il faut travailler. Beaucoup. Il faut des subventions, aussi, pour y arriver, je pense. Aux comédiens et à l’équipe de tournage, je ne leur envoie pas du rêve. Pas de mensonges, pas de stratégie. Je suis cash, je leur dis que le budget n’est pas extensible et qu’on devra réaliser le court avec 5 000 et non 30 000 euros. Après, ils acceptent, ou pas.
Est-ce dur d’intégrer les festivals ?
Faut pas se mentir, y a des sujets tendance pour y rentrer. Demain, peut-être a été intégré à de nombreux festivals internationaux aussi car c’est un sujet tendance ! J’ai compris ça sur le coup. Le film, nombriliste, sur mes parents, est moins politique et a fait moins de festivals.
Idem pour les dernières Palmes d’or, les dix dernières traitent de sujets d’actualité ou de société, disons. C’est complexe : cela inciterait presque à se trouver uniquement des sujets « politiques » pour ses courts, mais c’est le risque de raconter des histoires qu’on ne maîtrise pas forcément… J’ai un avis assez tranché sur la question !
Vous avez une référence ultime dans le cinéma ?
David Fincher : House of Cards, Fight club, Seven, c’est de lui. Il parvient à traiter des sujets de société, tout en scotchant les gens. Il est talentueux et visionnaire. Avec House of Cards, dont les trois premières saisons sont grandioses, il a réalisé un vrai travail d’analyse pour comprendre ce qu’il se passe au cœur du pouvoir américain.
The social Network, du même réalisateur, m’inspire beaucoup également. Ce n’est pas le film le plus incroyable, mais un biopic au style épuré et dark. Il y a tout : proposition, analyse et prise de risque, ça m’a marqué ! Mêler spectacle et messages, c’est fort. Ladj Ly, avec Les Misérables, a réussi le coup, c’est plutôt rare, au final, je trouve.

Prendre des risques, c’est important ?
Je prends une référence de foot. Marcelo Bielsa, pour lui, jouer, c’est une prise de risque. C’est important. Il faut le faire pour se démarquer. Il ne faut pas avoir peur. Que cela plaise ou pas – c’est de l’art, donc cela reste subjectif. Toujours est-il que l’on reconnaîtra la prise de risque. Faut pas lâcher. Rester sur ses idées.
« Pour provoquer la réussite, il faut faire les grands festivals »
Lors d’un entretien à LFM radio, vous avez dit que vous vouliez « gagner ».
Je veux en effet gagner, même en jouant à Fifa. Je suis exigeant avec moi-même. Pour provoquer la réussite, il faut faire les grands festivals. Par exemple, la Palme d’or, c’est un but ultime. Avant de mourir, je ferai tout pour tenter de l’avoir. Je la considère comme une ligue des champions ou une coupe du monde. C’est gratifiant, et je veux affronter les plus grands, même David Fincher !
Quel est votre prochain objectif ?
Je prépare un long pour dans deux ans. Ce sera sur la liberté d’expression. Pour le moment, je n’en dis pas plus. Je ne sais pas si je peux en parler, mais je trouve que l’on ne peut plus dire grand-chose, c’est difficile de savoir ce que l’on doit dire, ne pas dire, on doit avoir une communication policée, dans le foot, dans l’art… Je m’arrête là. / Frédéric Emmerich
Son dernier court, Mainstream, est sorti en 2019. Nicolas Khamsopha évoque cette fois la vie d’un influenceur, prêt à tout pour rester… « en place ».