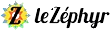Carmel est une domestique immigrée au Liban. À son arrivée il y a cinq ans, elle a été victime de violences sexuelles. Aujourd’hui, elle subit, comme tant d’autres femmes, un système d’exploitation raciste.
Carmel* est assise sur le lit de son petit appartement, loué dans le quartier de Nabaa, au Nord-Est de la capitale. Un quartier pauvre, où les câbles électriques relient les maisons entre elles et s’élancent entre les ruelles étroites. Dehors, des ribambelles de linge sèchent encore. Il est un peu plus de 20 heures, la nuit a déjà enveloppé les habitations beyrouthines.
Carmel est une Camerounaise et travaille comme domestique au Liban. Ses grandes boucles d’oreilles créoles encadrent son visage. Ses cheveux sont courts, crépus et teints en blond à leur extrémité. Elle parle vite, sans trop s’arrêter ; les mots sortent en cascade, fusent, s’entrechoquent. Elle voyage cinq ans en arrière : le jour où elle est arrivée au pays du Cèdre.
« Un véritable traumatisme »
Le 24 mai 2014, à la sortie de l’aéroport de Beyrouth, un homme attend Carmel pour la mener dans la famille de M. et Mme B.*, où elle doit travailler. La voiture file, et les paysages méconnus défilent. Puis de s’arrêter au milieu de nulle part, loin des lumières de la ville et du perpétuel concert de klaxons.
Plusieurs années après, éclairée par le halo blafard de l’ampoule de son appartement, la femme de 29 ans livre son histoire, à l’aide de phrases crues et violentes. « Il a éteint le moteur et m’a dit : ‘Je vais te faire l’amour et tu vas faire tout ce que je veux’ », raconte-t-elle. Tout se passe très vite, elle ne peut pas réagir. « Cet homme inconnu m’a enlevé de force mes habits, se souvient Carmel. Il m’a obligée à lui faire une fellation. Il m’a ensuite dit que ce serait ‘comme ça’ désormais, et que ce n’était que le début. »
La voiture a ensuite redémarré, en direction de la maison de M. et Mme B. à Bsous, une dizaine de kilomètres au sud de Beyrouth. « J’ai été malade deux semaines à cause du choc », explique Carmel. L’homme au volant était le grand-père de la famille, et elle allait le croiser pendant huit mois et demi.
Sur place, elle est logée, s’occupe des tâches ménagères, les courses, les repas… Et, régulièrement, elle tombe… sur son agresseur, le grand-père : « Quand j’étais seule dans la cuisine, il s’arrangeait pour me rejoindre. Il me touchait les fesses et me caressait, raconte-elle. Et, pour que je ne parle pas, il me menaçait. »
Lire aussi : Des épices et des papiers pour Evelyne
Travailler pour ses enfants
Cette situation a duré quatre mois. « Ça a été un véritable traumatisme », poursuit-elle. Au Liban, selon des chiffres relayés par le Mouvement anti-raciste, 7 % des femmes immigrées domestiques se sont déjà faites harceler sexuellement, 14 % ont été violentées, 52 % se sont faites injuriées ou humiliées verbalement et 60 % d’entre elles soulignent qu’elles ne sont pas toujours payées. Mauvaises conditions de travail, non-respect de leurs droits au quotidien… Leurs rêves d’une vie meilleure partent à la dérive, et la réalité les plonge dans la désillusion.
Si Carmel a décidé de venir au Liban, c’est pour envoyer de l’argent à ses trois enfants au Cameroun. À Yaoundé, la capitale, la jeune femme vendait des mangues et des oranges en bordure de route. Aujourd’hui, elle vit seule dans son appartement aux murs vert pistache. Un faux sapin de Noël encore enguirlandé traîne dans un coin et, sur le sol, un tapis rouge vermillon donne une touche d’éclat au décor.
La porte de l’appartement est entrouverte, l’écho de la discussion de la famille voisine résonne jusqu’aux oreilles de Carmel. « Ma famille me manque en permanence, confie-t-elle, j’échange beaucoup avec eux. » Un silence s’installe. Soudain, elle pousse un cri : une souris vient de passer devant la porte de son appartementSous l’emprise de la Kafala
Au Liban, elles seraient 250 000 femmes comme Carmel. Travailleuses domestiques immigrées, leurs droits ne sont pas régis par la loi. C’est la Kafala qui domine, ce système d’exploitation regroupant un ensemble de pratiques, qui lie directement la travailleuse domestique à l’employeur par le biais du visa d’emploi. La domestique est obligée d’entrer sur le territoire sous le nom d’un « sponsor ».
Une fois le contrat signé, il est presque impossible d’y mettre fin… sauf si l’employée est victime d’un abus physique, auquel cas il faut un certificat médical. Or, ces femmes ont peu accès au secteur médical. Il arrive aussi que l’employeur interdise les sorties, fermant la porte à clé, ou limite les appels téléphoniques. Le contrat peut se résilier si l’employeur ne paye pas l’employée pendant trois mois. Il faut pourtant apporter une preuve avec un reçu, document rare.
___________________________________________________________________________<Ne ratez rien de l'actualité du Zéphyr
___________________________________________________________________________
Passeport confisqué
Enfin, la dernière condition est recevable dans le cas où l’employée a un second emploi, autre que celui de travailleuse domestique. Fait tout aussi rare, lorsque l’employée loge chez son patron.
Petit à petit, Carmel découvre les magouilles et dérives de ce milieu, où le patron est roi, protégé par la Kafala. En 2015, une étude menée par l’université américaine de Beyrouth montrait que 94 % des employeurs confisquent le passeport de leur employée domestique immigrée, bien que le contrat ne le mentionne pas. « Mon passeport m’a aussi été confisquée quand je suis arrivée au Liban », déclare Carmel.
Pour l’ONG féministe laïque Kafa, qui vient en aide aux femmes domestiques et milite pour l’abolition du système patriarcal, la confiscation du passeport par l’employeur est un moyen de certifier que l’employée ne s’enfuira pas au cours de son contrat.
Lire aussi : Génocide arménien : les filles du calvaire de 1922
« J’ai failli sauter du balcon »
« Durant cette période, j’ai failli sauter du balcon à plusieurs reprises », précise Carmel, les traits fermés. En 2008, Humain Right Watch révélait que, chaque semaine, plus d’une domestique migrante trouvait la mort, « par suicide, où à la suite d’une tentative d’évasion ».
Carmel finira par sauter le pas au bout de huit mois et demi. La jeune femme avait pris l’habitude de photographier les noms de rues et les numéros de taxis affichés sur les devantures des magasins. Cette anticipation lui permettra de se repérer plus facilement le jour de son départ en douce.
Entre deux gorgées d’eau fraîche achetée au petit vendeur du coin, elle se souvient : « Chaque jour, je revivais les agressions dans ma tête, j’ai préféré partir avant de tuer quelqu’un. » Un matin où elle est seule à la maison, Carmel, à qui l’étiquette de domestique colle désormais à la peau, a rassemblé ses affaires dans une valise et a pris la fuite, direction : Beyrouth. Jamais, elle n’aura eu de nouvelles de la famille.
Sans papier, sans droits
Les jours suivant sa fuite, Carmel a fait appel à ses connaissances, et quelqu’un a fini par lui dégotter un p’tit boulot. En l’espace de quelques heures, sa situation sur le territoire libanais est devenue illégale, ayant brisé le système de la Kafala. Encore aujourd’hui, elle ne peut se rendre dans une agence de recrutement : elle n’a pas emporté son passeport avec elle en quittant son « sponsor », puisqu’il lui était confisqué. « De toute manière, il est maintenant périmé, déclare-t-elle, sans papiers, je n’existe pas, je n’ai aucune légitimité ici. »
La jeune femme est dans une situation des plus précaires, épuisée par son travail, elle ne peut ni se rendre chez un médecin, ni faire valoir ses droits. Un contrôle de police peut survenir n’importe quand, alors la peur s’est invitée comme camarade dans son quotidien. « Si je me fais arrêter, je peux aller en prison. Après tout, j’y passerai peut-être un an et je rentrerai chez moi. C’est comme ça », lâche-t-elle avec une moue de résignation.
Depuis trois ans, Carmel travaille aléatoirement dans différentes familles. En ce moment, elle est employée par un couple du milieu de l’événementiel. Elle n’est pas sous contrat, mais se rassure de ne plus subir de violence. Son rythme de travail reste difficile à tenir : « Comme il y a les anniversaires à organiser les week-ends, je travaille sept jours sur sept, mais j’ai vraiment besoin de gagner ma vie. » Elle reste malgré tout prisonnière d’un système qui ne lui donne aucun droit. « Ici, tu n’es rien, tu subis le racisme tous les jours, regrette-t-elle. Il est arrivé qu’on m’intimide, que des gens du quartier me demandent si j’ai mes papiers. »
Lire aussi : Les femmes et les hommes du Sahara
Témoigner pour dénoncer
Le besoin vital d’envoyer de l’argent à sa famille lui fait tenir sa situation. « Aujourd’hui, je ne gagne pas assez pour rentrer », poursuit Carmel. Pour faire avancer les conditions des femmes domestiques au Liban, elle a décidé de parler. « J’ai vécu tous les jours avec un traumatisme que je n’exprimais pas », annonce-t-elle.
Le 5 mai 2019, elle s’est jointe au cortège de la manifestation annuelle des femmes domestiques immigrantes, dénonçant le système de la Kafala. À l’issue de la marche, Carmel s’est emparée du micro pour raconter un morceau de son histoire. D’autres femmes, comme elle, ont parlé et dénoncé les violences sexuelles, l’exploitation, les suicides, les confiscations de passeports ou encore la surcharge de travail. Les témoignages ont résonné successivement : « Arrêtez de nous faire dormir sur les balcons, nous ne sommes pas des singes ! » ; « Non au viol. Non au violences sexuelles » ; « Il faut sortir de ce système, des femmes se suicident, il faut réagir ».
Lire aussi notre série : Que reste-t-il du Congo ?
Avant d’arriver au Liban, Carmel voulait travailler dans l’informatique. Par manque de moyens, elle n’a pas suivi d’études. « Depuis que je suis ici, mon esprit est ailleurs. Je ne suis plus moi », souffle la jeune femme. Soudain, une sonnerie résonne dans son studio du quartier de Nabaa. Carmel finit par décrocher à sa grande sœur restée au Cameroun, et son visage s’éclaire. Elle prend des nouvelles de sa famille, demande qu’on lui envoie des photos de ses enfants qu’elle n’a pas vus depuis 5 ans. De quoi replonger quelques instants dans le souvenir de sa vie au Cameroun ! / Malika Barbot
* Les prénoms ont été changés, les protagonistes gardent l’anonymat.